les démocraties parlementaires européennes, des négociations – souvent longues – permettent la formation de coalitions gouvernementales fonctionnelles. Les échecs répétés des gouvernements français depuis la dissolution de juin 2024 invitent à s’intéresser aux pratiques éprouvées en Allemagne, en Belgique ou en Espagne.
En le nommant le 9 septembre, Emmanuel Macron avait chargé Sébastien Lecornu de « consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget et de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois » avant de lui « proposer un gouvernement ». Une démarche qui pouvait augurer un mode de gouvernance se rapprochant des pratiques en vigueur dans les régimes parlementaires européens. Une telle conversation reste sans doute la seule issue à la fragmentation actuelle du système partisan et parlementaire de la France.
La tradition parlementaire dans « les démocraties de consensus »
Après des législatives, dans les régimes dits « parlementaires » ou dans les « démocraties de consensus », les forces politiques consacrent souvent un temps important à négocier, dans l’objectif de conclure un accord, voire un contrat de gouvernement et de législature. Dans la célèbre classification d’Arend Lijphart, ce dernier distingue les « démocraties de consensus » des « démocraties majoritaires » où le pouvoir est concentré dans une simple majorité, voire un seul parti et son chef, cas fréquent dans le modèle de Westminster (inspiré du Royaume-Uni, ndlr). Les « démocraties de consensus » sont celles où, par le mode de scrutin, par le système partisan et par la culture politique, des familles politiques aux orientations et intérêts parfois éloignés sont contraintes de se partager le pouvoir.
Les modalités de formation des gouvernements de coalition et des contrats de législature varient selon les pays et leurs propres traditions et systèmes partisans. Mais le principe central demeure le même : lorsqu’aucun parti ni aucune coalition préélectorale n’obtient de majorité suffisante pour prétendre gouverner, les forces parlementaires négocient un accord de compromis. Ce dernier comporte souvent deux aspects. D’une part, la répartition des postes ministériels, d’autre part, une base minimale de politiques publiques à mener – y compris pour obtenir un soutien sans participation ou une non-censure de la part des groupes qui n’entrent pas au gouvernement.
De telles négociations ont le défaut d’être souvent très longues – des semaines, voire des mois – et parfois de passer par plusieurs échecs avant d’aboutir à un compromis à l’équilibre délicat. Toutefois, lorsque ce compromis est trouvé, il peut permettre une relative stabilité pendant plusieurs années, et a l’avantage de réunir des parlementaires qui représentent une majorité effective de l’électorat – tandis que les gouvernements français s’appuient sur un soutien populaire de plus en plus étroit.
L’Allemagne est prise en exemple pour sa tradition de coalitions. Celles-ci sont négociées pendant des semaines, formalisées dans des contrats prévoyant des politiques gouvernementales précises pour la durée du mandat. Après les élections fédérales du 26 septembre 2021, il a fallu attendre deux mois pour que soit signé un contrat de coalition inédite entre trois partis – sociaux-démocrates, écologistes et libéraux. En 2025, après les élections du 23 février, l’accord pour une nouvelle grande coalition entre conservateurs et socialistes n’est conclu que le 9 avril.
La période de discussion entre partis politiques représentés au Parlement peut même être encore plus longue. Le cas est fréquent en Belgique, où les divisions régionales et linguistiques s’ajoutent à la fragmentation partisane. Près de huit mois se sont ainsi écoulés entre l’élection de la Chambre des représentants, le 9 juin 2024, et la formation du nouveau gouvernement, entré en fonctions le 3 février 2025, composé de la « coalition Arizona » entre chrétiens-démocrates, socialistes, nationalistes flamands et libéraux wallons.
Les procédures sont largement routinisées. Après chaque scrutin fédéral, le roi des Belges nomme un « formateur » chargé de mener les consultations et négociations nécessaires pour trouver une majorité fonctionnelle pour gouverner. En cas de succès, le « formateur » devient alors le premier ministre. L’identification du formateur le plus susceptible de réussir sa mission est une prérogative non négligeable du souverain.
Lorsqu’un régime politique se heurte à une configuration partisane et parlementaire inédite, il arrive que l’adaptation à cette nouvelle donne prenne du temps. L’Espagne offre cet exemple. Après les élections générales d’avril 2019, aucune majorité claire ne s’est dégagée et Pedro Sanchez, président du gouvernement sortant et chef du Parti socialiste arrivé en tête, a d’abord voulu conserver un gouvernement minoritaire et uniquement socialiste. Ce n’est qu’après deux échecs lors de votes d’investiture en juillet, puis une dissolution et de nouvelles élections en novembre, que le Parti socialiste et Podemos se sont finalement mis d’accord sur un contrat de coalition pour un gouvernement formé en janvier 2020 – première coalition gouvernementale en Espagne depuis la fin de la IIe République (1931-1939).
Un élément notable de ces pratiques parlementaires est que l’identification du camp politique et du candidat en mesure de rassembler une majorité n’est pas toujours immédiatement évidente, et qu’un premier échec peut se produire avant de devoir changer d’option. Ainsi, en août 2023, toujours en Espagne, lorsque le roi a d’abord proposé la présidence du gouvernement au chef du Parti populaire (droite espagnole), arrivé en tête des élections de juillet. Ce n’est qu’après l’échec du vote d’investiture de ce dernier que Pedro Sanchez a pu à nouveau tenter sa chance. Grâce à un accord de coalition avec la gauche radicale Sumar et un accord de soutien sans participation avec les partis indépendantistes catalans et basques, il a finalement été réinvesti président du gouvernement.
Vers une lente parlementarisation du régime français ?
Au regard des pratiques dans les régimes parlementaires européens habitués aux hémicycles très fragmentés et sans majorité évidente, la France n’a pas su, jusqu’ici, gérer la législature ouverte par la dissolution de juin 2024. Le temps record (pour la France) passé entre l’élection de l’Assemblée nationale et la formation d’un gouvernement n’a pas été mis à profit.
Ainsi, malgré les consultations menées par le président Macron pour former le gouvernement, la coalition du « socle commun » entre le « bloc central » et le parti Les Républicains (LR), base des gouvernements Barnier et Bayrou, n’a fait l’objet d’aucune négociation préalable ni d’aucune sorte de contrat de législature. De même, les concessions faites par François Bayrou aux socialistes pour éviter la censure du budget 2025 n’ont pas donné lieu à un partenariat formalisé, et les relations se sont rapidement rompues.
En confiant à Sébastien Lecornu, la charge de mener les consultations pour « bâtir les accords indispensables », le président Macron avait semblé acter ne pas être en mesure de le faire lui-même. Mais le premier ministre s’est heurté à la difficulté de reconduire un « socle commun » déjà fragile et surtout d’aboutir à un accord de non-censure avec au moins l’un des groupes d’opposition, malgré l’engagement de ne pas recourir à l’article 49.3 et de laisser faire la délibération parlementaire.
Dans une Assemblée nationale aussi fragmentée que la XVIIe législature, tout gouvernement ne peut se maintenir et tout budget ne peut être adopté qu’avec le soutien ou au moins la tolérance de deux des trois blocs – ou bien d’une partie d’entre eux. Si une grande coalition ou, à défaut, un gouvernement minoritaire mais avec un accord de non-censure, devait exister, il nécessiterait des négociations sérieuses et longues et, surtout, des engagements réciproques de concessions et de compromis substantiels entre la gauche et le centre droit, en particulier sur la répartition de l’effort budgétaire entre les ménages, les entreprises et l’État.
La détermination du président Emmanuel Macron à préserver l’essentiel de son bilan politique, surtout concernant la baisse de la taxation des plus riches et la réforme des retraites, a longtemps empêché d’aboutir à ce scénario parlementariste. Tant que persistera la fragmentation partisane de l’Assemblée nationale – et rien ne garantit que de futures élections y mettraient fin – la classe politique française devra apprendre à se convertir aux pratiques parlementaires européennes. Un apprentissage qui n’a que trop stagné.
RSA avec Theconversation
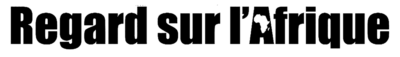











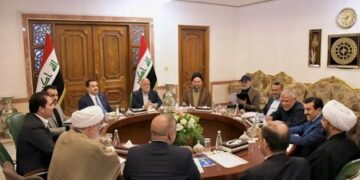










































Discussion à propos du post