Au terme de la première année de l’apparition inopinée de la crise sanitaire dont les origines remonteraient à la ville de Wuhan (dans la province de Hubei, en Chine), son impact a été visible dans plusieurs domaines à travers le monde. Il est indéniable de constater que les principaux domaines impactés dans le monde sont sur les plans sociaux (les services de santé saturés, les pertes en vies humaines, etc.) et économiques (la baisse des prix des hydrocarbures, l’arrêt des importations et des importations des matières premières, le rabais des revenus liés au tourisme, etc.).
À l’image du monde entier, le continent africain n’a pas été épargnée par ces ravages. Bien que le continent s’en sort avec un bilan humain des plus élogieux contrairement au reste du monde, remettant en cause les prévisions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) , l’Afrique n’est cependant pas épargnée des revers économiques. En effet, nombre de pays africains ont vu leur PIB régressé progressivement et les lois de finances pour l’exercice 2020 ont été réajusté afin d’amortir au mieux l’impact économique de cette crise. Dans la foulée, les prévisions économiques du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont été revues à la baisse, tenant compte de l’impact de la pandémie. Face aux prémices qui annoncent un lourd bilan économique, les pays africains réagissent mais de façon disparate.
Les décisions économiques prises dans l’immédiat par ces derniers visent à soutenir les ménages (selon les pays), ainsi que les entreprises publiques et les PME. L’objectif recherché serait de préserver, un tant soit peu, les acquis au plan économique, d’éviter au maximum la faillite des entreprises et surtout l’explosion du taux du chômage. Bien que salutaire, la principale conséquence de ces actes est inéluctablement l’inflation de la dette intérieure et extérieure de ces pays.
Le continent africain semble être dans l’agonie et dans une impasse économique. Elle a urgemment besoin d’étudier toutes les stratégies visant, à court terme, à relancer son économie ; à répondre à la dette intérieure et extérieure dans le moyen terme ; et dans le long terme, à réétudier les voies et moyens devant conduire au développement. Le sommet de Paris sur le financement de l’économie africaine (18 mai 2021) se moule dans ce sillage, une table ronde internationale devant étudier les possibilités pour relancer l’économie africaine. Cet essai analytique vise à améliorer la compréhension du jeu et des enjeux qui gravitent autour
d’un sommet qui semble tomber à point nommé. Dans cette veine, se limiter à l’objectif décliné pourrait engendrer le risque de passer à côté de certaines lectures pourtant capitales. Ainsi, il serait convenable de souligner le contexte international afin de mieux analyser cette rencontre.
I- UN CONTEXTE INTERNATIONAL DÉFAVORABLE POUR L’ÉCONOMIE AFRICAINE
Doté d’innombrables ressources offertes par la nature, les pays africains peinent à s’insérer depuis des décennies dans le marché international. Disposant d’un tissu économique diversifié mais extraverti, c’est un continent à forte production dont l’écoulement de ses
produits dans l’économie internationale constitue une grande source de son PIB. Cependant, l’Afrique n’a pas une place considérable dans celle-ci, elle représente à peine 3% du marché international. Plongée dans ce qui serait une léthargie économique dû aux effets de la pandémie, l’urgence se fait de plus en plus vive. À la suite des mesures de riposte contre la pandémie pour limiter les dégâts, les pays africains partagent un objectif : relancer leur économie.
1- Les mesures de riposte prises par les pays africains contre la pandémie
Face à la propagation croissante de la pandémie, les pays africains ont pris leurs responsabilités. De façon graduelle, des mesures de préventions ont été prises afin de limiter la transmission et la propagation du virus auprès des populations. Ces mesures barrières sont entre autres : le couvre-feu partiel au confinement, l’établissement des cordons sanitaires, la fermeture des frontières, des écoles, des bars, des lieux de cultes, le port obligatoire des masques, le lavage régulier des mains, l’institution du télétravail, l’instauration de la distanciation sociale, l’interdiction des rassemblements ou des regroupements de plus de 10 personnes, le dépistage systématique et la prise de température . À ces méthodes, s’ajoutent les campagnes de vaccination contre la COVID-19 observées dans plusieurs pays africains.
Au regard de ces mesures de riposte, force est de constater que les stratégies d’intervention varient selon les pays et qu’il n’existe aucune coordination entre ces pays, voire les régions. Quant à elle, l’Union Africaine (UA) est restée en retrait dans cette bataille car aucun plan cohérent de gestion de crise n’a été fourni aux États. En effet, l’organisation panafricaine a manqué de moyens juridiques, institutionnels, humains et financiers pour coordonner une action africaine de lutte contre la pandémie. Seul un programme de renforcement de la réponse africaine à la pandémie 4 a été conjointement mis en place par la Commission de l’UA, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Ces actions disparates ont démontré, une fois de plus, que l’Afrique est loin de s’unir pour proposer une réponse africaine face à une urgence, ce qui est contraire à la vision de l’Agenda 2063 dont l’objectif est de parvenir à « une Afrique unie, intégrée et prospère ». À
l’inverse, les mesures adoptées par les gouvernements paraissent lourdes de conséquences, notamment aux plans social et économique. Cela expose les populations à une économie de subsistance et à la précarité, surtout pour celles qui dépendent de l’économie informelle. Dans un rapport de l’OCDE, l’onde de choc du COVID-19 dans les économies africaines se propage en trois vagues : premièrement, la baisse des échanges avec la Chine et ses investissements ; deuxièmement, l’effondrement de la demande associée aux mesures de confinement dans les pays de l’UE et de l’OCDE ; et troisièmement, un choc d’offre à l’échelle du continent affectant le commerce intérieur et intra-africain 5 (lequel est passé de 13% à 10% en 2020). Ce ralentissement de l’économie africaine aura inéluctablement de graves répercussions sur l’opérationnalisation, l’efficacité et les résultats de la Zone de libre- échange continentale africaine (ZLECAf). Nonobstant ces dégâts, il faut trouver des stratégies pour que les ménages vivent.
2- L’urgence d’un plan de relance pour l’économie africaine
Le coût financier des mesures barrières a été insoutenable pour certains pays. Cependant, une question centrale demeure et revient avec insistance : comment relancer l’économie africaine ? Pour avoir une chance d’y parvenir, la principale équation est de réduire au maximum la dette extérieure auprès des partenaires et créanciers internationaux. Pour y parvenir progressivement, quelques pistes sont étudiées. Les pays africains et l’UA ont sollicité, auprès des principaux donateurs et prêteurs internationaux (Tableau 1), l’annulation de la dette africaine (365 milliards de dollars en 2020) et leur soutien pour redresser leur économie. Cette insoutenabilité de la dette extérieure des pays africains (Tableau 2) a engendré, de commun accord, un rééchelonnement de la dette.
Ceci ne signifie pas que la dette de ces pays a été purement et simplement annulée, mais plutôt qu’un moratoire a été accordé jusqu’au terme de la pandémie 6 , l’actuelle maîtresse du temps. Le G20 a favorablement souscrit à cette requête (un moratoire d’un an a été accordé). Le FMI lui emboite le pas et décide de fournir 11 milliards de dollars à 32 pays d’Afrique subsaharienne ayant sollicité une aide financière (notamment le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, Madagascar, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo). Dans la foulée, des droits de tirages spéciaux (DTS) ont été accordé aux africains afin de faciliter l’aide aux financements. De leur côté, l’ONU et la Banque Mondiale restent attentifs à cette doléance. Grande période, à conseiller les États et à fournir de façon journalière des statistiques relatifs aux cas de contamination, de rémission et de décès selon les pays. 5 Organisation de Coopération et de Développement Économique, L’Afrique face au COVID-19 : Implications socio-économiques régionales et priorités politiques, mai 2020.
À l’occasion du 20 ème Forum économique international sur l’Afrique qui a eu lieu le 22 février 2021, le Président sénégalais, S.E Maki SALL, a demandé la prolongation du moratoire sur la dette, qui s’achève le 30 juin, afin de l’étendre à toute l’année 2021. Le but de ce moratoire est d’augmenter les ressources financières qui permettront au continent de préparer l’après-Covid. Outre cette requête, il a également émis le vœu de réformer la gouvernance économique et financière au niveau international, lequel est défavorable aux économies africaines. Pour sa part, le Président français, Emmanuel MACRON, plaide auprès des institutions de
Bretton Woods et d’autres investisseurs privés pour l’annulation pure et simple de la dette africaine, dont 40% proviennent de la Chine et 60% viennent d’autres investisseurs privés.
Sachant que ces pistes peuvent ne pas aboutir au degré souhaité 8 , il serait judicieux pour les pays africains de murir des pistes de réflexions tout en réduisant le recours à l’aide publique au développement (APD). Pour réduire cette dépendance excessive, l’UA doit
prendre ses responsabilités et proposé aux pays africains un plan de relance afin de reconstruire la société et l’économie du continent.
II- LA RELANCE ÉCONOMIQUE AFRICAINE : ENTRE L’URGENCE DES PAYS
AFRICAINS ET UNE PRIORITÉ DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Suite aux catastrophes économiques, les pays africains semblent se heurté à un granddéfi : la difficulté de mettre sur pied un programme continental de relance économique. Lerécent sommet de Paris (18 mai 2021), dont l’objectif est de trouver les financements nécessaires pour l’économie africaine, serait une opportunité pour le continent. Mais au-delà de l’aspect économique, il serait judicieux de questionner les dessous de table. Ainsi, analyser le jeu (1) et les probables enjeux de ce sommet pourrait ressortir des éléments de réponse.
1- Paris, au centre des préoccupations africaines ?
Relancer l’économie de tout un continent n’est pas une partie de plaisir, surtout quand l’on sait que les revenues économiques de ce dernier dépendent fortement de l’APD et des exportations massives des produits agricoles et miniers. Associer à cela, il faudrait rappeler que le marché international est à l’arrêt, l’une des causes de l’inflation et du surendettement de nombreux pays africains. Nonobstant la grandeur de la tâche, il est important voire judicieux de rassembler tous les pays qui forment l’icône de l’économie du continent, selon les sous-régions si l’on voudrait trouver des solutions pour relancer l’économie du continent et que celles-ci soient implémentés avec succès.
Paris use de son passé historique et de sa proximité avec l’Afrique pour s’approprier cette tâche et organise une rencontre internationale. Mais après observation des pays africains invités et présents à celle-ci (Tableau3), il apparait que cela n’a pas été fait. En effet, certaines icônes de l’économie du continent sont présentes (l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie), mais d’autres manquent à l’appel (notamment le Cameroun). Si les troubles sociopolitiques et le manque de traçabilité quant à la gestion des finances dédiés aux projets structurants sont les raisons de l’absence du Cameroun, le poumon économique de la zone CEMAC, ces critères discriminatoires devraient également s’étendre à de nombreux pays africains invités.
Face à cela, l’on pourrait plutôt penser que ce casting découle d’un choix stratégique et politique au détriment d’un choix économique. Deux raisons pourraient plutôt justifier ces choix. Premièrement la forte présente des pays francophones d’Afrique de l’Ouest viendrait
du fait que « l’Afrique de l’Ouest et précisément la zone du Sahel est la région où la France considère qu’elle a encore des responsabilités ». Deuxièmement, face à la dégradation progressive de l’image de la France en Afrique francophone, « Emmanuel Macron tente de changer la donne en s’investissant, hors du pré carré, dans les grandes économies du continent : Égypte, Nigéria, Éthiopie, Angola, Afrique du Sud ». La qualité de ce casting pourrait donc contenir des intérêts inavoués, lesquels seraient au-delà de l’aspect économique.
2- Les enjeux probables de la Conférence de Paris
Les principaux enjeux de cette importante rencontre sont inéluctablement la levée des fonds pour soutenir la relance économique des pays africains et accélérer la campagne vaccinale contre le Coronavirus en Afrique. Dans cette veine, le FMI s’engage à soutenir les
africains. Pour renforcer la réponse face à cette pandémie, l’institution internationale estime que 285 milliards de dollars sur la période 2021-2025 seront nécessaires aux pays africains. Il semblerait que ces objectifs soient l’arbre qui cache la forêt car d’autres enjeux seraient dissimulés derrière cette rencontre internationale, notamment pour la France qui souhaite redéfinir sa politique étrangère vers l’Afrique.
Grâce à une diplomatie de coopération et de médiation accentuée, contrairement à d’autres partenaires internationaux du continent, la France laisse savoir qu’elle se sent beaucoup plus concerné par ce gigantesque chantier. Au rang des probables enjeux inavoués de celle-ci, figurent la préparation du prochain sommet France-Afrique (initialement prévu les 8, 9 et 10 juillet 2021 à Montpellier, il est reporté du 7 au 9 octobre 2021).
Cette rencontre qui rassemblera à nouveau les dirigeants africains sera une fois de plus l’occasion pour proposer des solutions d’aide à l’Afrique pour mieux préparer sa période post-Covid (la relance économique, la coopération internationale en vue d’améliorer le développement durable, les discussions autour de la future monnaie de l’Afrique de l’Ouest, etc.). Outre cela, un enjeu serait plus important pour la France : retrouver son statut et renforcer sa présence économique, diplomatique et militaire sur le continent afin de rivaliser ses rivaux (notamment l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, Grande-Bretagne, l’Israël, l’Italie, le Japon, la Russie et la Turquie) qui gagnent continuellement du terrain car « À l’exception notable du groupe Total, le potentiel des investisseurs français s’est réduit comme une peau de chagrin. Seuls survivent, plutôt bien, les & quot;paters familias" implantés de longues dates sur le continent avec des réseaux personnels dans les cercles de pouvoir, à l’instar de Vincent Bolloré, Martin Bouygues, Pierre Castel,
L’objectif ici serait de réduire au mieux la flambée du sentiment anti- français, lequel se propagerait à grande vitesse en Afrique Subsaharienne. Toutes ces enjeux savamment pensés pourraient servir un intérêt qui, cette fois-ci, serait personnel à Emmanuel
MACRON : la préparation des prochaines élections présidentielles prévues en 2022. Dans cette veine, avoir un bilan positif à défaut d’être élogieux sur le plan national et international est un impératif. Malgré les revers enregistrés au plan national, le continent noir pourrait aider la macronie à obtenir ce bilan sur le plan international. Il est donc important de « séduire » ce
continent.
CONCLUSION
La pandémie a certes causé de nombreux dégâts (aux plans sociaux et économiques) mais elle offre la possibilité, à ceux qui sont prêts de la saisir, de redéfinir les rapports internationaux. Cependant, l’urgence actuelle de l’Afrique n’est pas tant de redéfinir les rapports internationaux mais il s’agit plutôt de définir un plan continental visant à relancer l’économie. Ce plan de relance permettra de redresser progressivement la pente et pourrait favoriser une meilleure présence de l’Afrique dans l’économie internationale.
Mais pour élaborer cette stratégie continentale, des préalables doivent être surpassés pour qu’elle remplisse les estimations escomptées. Le premier préalable renvoie à la dette extérieure et intérieure du continent. Il convient d’élaborer des stratégies permettant de mobiliser les finances nécessaires pour répondre ou réduire progressivement ces dettes. Avec ce goulot d’étranglement qui perdure durant des années voire des décennies, il est quasi impossible d’envisager résolument le redressement de l’économie du continent. Le second préalable semble être le plus difficile à atteindre : celui de la mobilisation des acteurs étatiques et institutionnels africains pour une cause commune.
Cette mobilisation requiert la pleine participation de tous ces acteurs (l’unité africaine) afin d’élaborer une stratégie commune à la pandémie, laquelle devra tenir compte des particularités de chaque sous-région. Ceci voudrait dire que l’UA devra prendre ses responsabilités à bras le corps, être aux avant-postes pour élaborer une stratégie continentale de riposte contre la COVID-19 et coordonner l’action de celle-ci à travers les CER, les pays et les OSC.


Par SI-BELL Steeve Romaric
Regard Sur l’Afrique
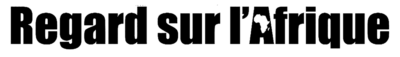
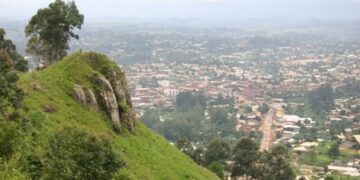




















































Discussion à propos du post