Le pays a eu un président inamovible, mais peu d’État. Sous sa longue férule, les institutions n’ont pas grandi. Notre experte propose d’en finir avec la personnalisation du pouvoir, la défaillance organisée, pour esquisser enfin une gouvernance d’après.
La cause est entendue, c’est acté, le président de la République est candidat et il est fort possible qu’il soit réélu pour au moins deux raisons: les militants vont s’impliquer chacun en ce qui le concerne pour assurer sa victoire sur toute l’étendue du territoire, ni le temps ni les moyens ne seront économisés dans l’espoir d’une récompense méritée plus tard. À cela, il n’échappe à personne que les voix des électeurs comptent, mais ceux qui comptent les voix comptent plus.
Le ministre Garga Haman Adji avait dit que «même sur une civière, si le président de la République est candidat, il serait élu». Fort de cette hypothèse, l’objectif de la présente production est d’analyser le contexte de l’élection marqué par: des revendications diverses, des rivalités communautaires et corporatistes, une baisse du leadership politique et administratif avec des défiances animées par divers acteurs au sein et en dehors du sérail et d’autres déviances dont l’énumération ne pourrait être exhaustive ici.
Parmi les griefs souvent entendus, on note la faible prise en compte dans les instances de décision des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap au point où cette préoccupation fait l’objet d’annonces de campagnes et des promesses
D’ailleurs, la phase du processus relative à la réception des candidatures nous a montré à quel point les Camerounais sont capables de désacralisation de la fonction présidentielle et, par là, des institutions républicaines. Pour moi, l’élection présidentielle de 2025 aura un nom: incertitude! L’incertitude est définie par un état de doute sur l’avenir ou sur ce qu’il convient de faire. Elle est marquée à la fois par la peur et l’espoir. La peur est adossée sur des dysfonctionnements de gouvernance et l’espoir sur l’exigence de penser la gouvernance d’après 12 octobre avec réalisme et courage. Le président de la République aura 100 ans à la fin de son mandat!
- La peur est au cœur de l’élection présidentielle de 2025
Je constate avec désolation au moins quatre principales peurs réparties en deux groupes: la posture des citoyens et les phénomènes spécifiques de gouvernance. Peurs inhérentes à la posture des citoyens Il s’agit ici de la faible confiance vis-àvis des institutions et la disparition de l’homme providentiel. La première peur est la difficulté des institutions à rassurer et à inspirer confiance. Les raisons de cette réalité sont diverses, certaines subjectives et d’autres objectives. La question de la subjectivité s’appuie sur la confiance de plus en plus douteuse envers les institutions de la République. Le soupçon de la fraude est permanent, parfois injustifié en ce sens qu’il ne repose sur aucun fondement, juste sur des convictions et des opinions, souvent justifié au regard des témoignages des acteurs politiques considérés comme crédibles du fait de leur implication dans les élections.
C’est alors qu’on peut laisser croire que, qu’importent les efforts fournis par les décideurs publics ou malgré la transparence affichée des institutions en charge des élections, la connivence avec le parti au pouvoir est soupçonnée. Sur un autre plan, il existe des raisons objectives qui légitiment la faible confiance envers les institutions, notamment la tolérance souvent considérée comme une variable de compassion ou d’apaisement même dans des situations qui exigent la plus grande rigueur.
En effet, comment imaginer qu’on ait pu avoir 83 dépôts de candidatures à Elections Cameroon? Comment est-ce possible? Comment est-ce envisageable? La loi prévoit que la direction générale d’Elecam reçoive et transmette les dossiers de candidature au conseil électoral qui les examinera sur la forme et le fond. Il n’est pas interdit au conseil électoral de prendre un acte indiquant le contenu du dossier de candidature dans le cadre d’un manuel de procédures ou d’un règlement intérieur qui est prévu dans la loi électorale. Même en l’absence de cet acte, on verrait bien que la direction générale d’Elecam peut disposer d’une marge de manœuvre pour rejeter des candidatures manifestement non conformes.
Comment imaginer qu’on puisse avoir à analyser un dossier d’un candidat de 26 ans ou de 31 ans alors qu’il faut avoir au moins 35 ans au moment de l’élection? Comment pouvons-nous expliquer que l’on reçoive des candidatures indépendantes alors que l’on sait que seul le Rdpc, au regard des postes électifs dont il dispose, peut s’en prévaloir? Le contexte actuel permet d’avoir presque essentiellement tous les candidats investis par un parti, qu’il s’agisse de son parti d’origine ou d’un parti d’emprunt. Comment imaginer alors que l’on reçoive, néanmoins, les candidatures dites indépendantes qu’il serait presque impossible de l’être, en dehors des militants du Rdpc – et encore… Cette inflation de candidature est à mon avis la preuve de ce que les institutions restent pour la plupart très administratives au sens d’appliquer les textes sans outils de gouvernance visant à faciliter leur mise en œuvre.
On parle alors de manuel de procédures et dans certains cas de règlement intérieur. On ne gère pas avec les lois et décrets affichés au mur, il faut bien disposer d’outils de gouvernance(1). La preuve: au final, le 26 juillet 2025, ELECAM annonce que sur 83 candidatures, 13 ont été retenues soit 70 rejets. Le 4 et 5 août, les juges du Conseil constitutionnel ont ainsi rejeté une autre candidature, ce qui laisse le nombre à 12. C’est la preuve que le processus de sélection a un problème: celui du filtre à l’entrée.
La deuxième peur fait observer que l’homme providentiel a disparu; il n’est plus d’actualité. Voilà ce que nous devons désormais assumer avec courage. Et donc, les promesses et discours, bien que relevant de bonnes intentions sur les qualités des candidats, séduisent de moins en moins. Venant du parti au pourvoir, ces promesses rencontrent un auditoire qui revendique des commodités hygiéniques: eau, électricité, voiries, communication, un logement décent, entre autres. Du coup il leur est reproché de n’avoir pas pu, en 43 ans, améliorer leur bien-être. Les partis alliés sont tancés sur leur proximité passive avec le gouvernement et le faible impact de leur alliance sur les populations.

L’ancien président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Maurice Kamto devant le Conseil Constitutionnel le 5 août 2025 à Yaoundé. Photo . FB
Aux partis d’opposition, il leur est reproché de vendre du «vent». Bien que le changement soit une aspiration de tous, il semble évident qu’il faudra du temps pour espérer bénéficier de l’impact des réformes si tant est qu’elles seront conduites avec efficacité. Nous devons reconnaître sans détour, avec honnêteté et fermeté qu’en 2025 le discours sur l’homme providentiel et la posture messianique ne sont plus attractifs. Peurs relatives aux phénomènes spécifiques de gouvernance Deux phénomènes retiennent notre attention: la question de l’inclusion (avec une focalisation sur la question communautaire et la préoccupation du genre) et l’austérité inévitable qui nous tend généreusement la main. La troisième peur concerne donc l’inclusion. En effet, parmi les griefs souvent entendus, on note la faible prise en compte dans les instances de décision des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap au point où cette préoccupation fait l’objet d’annonces de campagnes et des promesses. Sauf qu’après l’élection, cette promesse est minimisée, voire ignorée. Bien plus, les dernières élections municipales et régionales ont laissé un triste souvenir à ces deux catégories de la population, zéro femme présidente de région, juste une trentaine de femmes maires sur 360, aucune femme maire de ville.
L’absence des jeunes de moins de 35 ans à ces postes est également une belle curiosité au regard de leur importance quantitative et qualitative. En conséquence, la question du renouvellement intergénérationnel devient un enjeu de survie. La question intergénérationnelle est sans doute l’une des plus grandes plaies du fonctionnement actuel de notre société. La longévité observée aux postes de gestion (ministres, directions générales, présidents de conseil d’administration, projets et programmes divers) est l’indicateur le plus révélateur de ce que le cycle intergénérationnel est en panne. Nous avons des records de longévité de 45, 30, 25 ans au poste, je voulais dire aux mêmes postes.
La place croissante du secrétariat général de la présidence de la République mérite d’être soulignée en tant qu’institution en charge du pilotage de la performance des administrations placées sous son giron.
Cette situation empêche les jeunes d’espérer devenir des adultes et aux adultes de devenir des aînés et plus tard des ancêtres. La quatrième peur est incarnée par l’austérité déjà ambiante et qui pourrait s’amplifier au regard des tendances économiques, des décisions et comportements inefficients qui caractérisent certains projets. Au fond, en pareil contexte, l’efficience doit être le mot d’ordre. Pourquoi mettre en place un dispositif aussi important à la réception des candidatures alors qu’aucune analyse n’y est faite? Sans convoquer les coûts cachés de cette opération de réception des dossiers, elle entraîne des coûts humains, matériels et en temps. Ceci n’est qu’un exemple factuel au regard de l’actualité.
Plusieurs exemples de projets et décisions peuvent illustrer cette réalité. La peur ici n’est pas seulement basée sur les ressources gaspillées, mais également sur le modèle de développement retenu. En effet, depuis vingt-deux ans(2), des actions sont menées, des ressources sont déployées, mais nous n’arrivons pas à nous rapprocher des taux de croissance projetés. Si certains brandissent les chocs externes, ce qui est tout à fait vrai, il faut néanmoins reconnaître que la malgouvernance interne pourrait justifier que ces chocs nous fragilisent, invitant à changer de modèle de gouvernance. À défaut d’opter pour un État fédéral, l’État a choisi la décentralisation avec une implémentation très lente du point de vue des maires et des résultats actuellement atteints.
Bien plus, la gestion de la question communautaire ne semble pas avoir trouvé un équilibre qui soit viable. L’incertitude sous le prisme de la peur présentée ci-dessus serait fatale si elle n’était pas accompagnée d’un dispositif de gouvernance qui nourrirait l’espoir d’un avenir meilleur.
- L’espoir à travers de nouveaux outils de gouvernance
L’âge du Président peut être considéré comme un sujet tabou ou un sujet à éviter si on «veut voir ses enfants grandir». Mais à y voir de près, tout le monde s’inquiète de l’avenir. Les causeries dans les chaumières ne sont plus un secret sur la question, les évêques, les acteurs de la société civile, les journalistes nationaux et étranges évoquent la question. Il ne s’agit pas pour moi de me limiter aux inquiétudes ou de ne faire que des commentaires, mais d’apporter des propositions concrètes qui puissent permettre de disposer d’outils viables dans un pareil contexte.
À partir du moment où il n’y a plus de doute sur sa candidature, nous avons de bonnes raisons de faire des propositions qui vont permettre, je l’espère et je le dis très modestement, de conduire l’action gouvernementale. Il n’échappe à personne que l’âge est une variable de gouvernance dont on ne peut faire l’économie quand il s’agit de gérer une entreprise, à plus forte raison un pays. L’âge ici n’est pas seulement biologique/génétique, il a une incidence sur la santé du dirigeant. La santé des dirigeants a fait l’objet d’un intérêt scientifique. Il apparaît que la santé du dirigeant, sa motivation et ses compétences sont les premiers intrants à son travail.
À ce sujet, plusieurs auteurs reconnaissent que la santé doit faire l’objet d’une attention particulière. Sans être spécialiste du domaine, nous retenons que celle-ci peut s’affaiblir avec l’âge, bien que ce ne soit pas le seul argument qui pourrait justifier l’affaiblissement. Nous avons des jeunes qui ont une santé fragile et des vieux qui ont une santé de fer. Quoi qu’il en soit, après 90 ans il peut arriver qu’on ait besoin d’attention plus qu’à 50 ou 70 quand on se compare à soi-même.

C’est fort de cela qu’il devient urgent de repenser les outils de gouvernance pour les adapter au nouveau profil du prochain probable président de la République.
Comme je l’assumais à l’introduction, au moins deux raisons nous laissent croire (on peut se tromper, c’est une conjecture à notre avis très probable) que le président Paul Biya succèdera à lui-même.
Dans ce contexte, il avoisinera 93 ans et achèvera son mandat à 100 ans. L’analyse ici vise à faire un état des lieux du dispositif de gouvernance actuel en ce qui concerne spécifiquement les outils de pilotage de l’action gouvernementale, et suggérer des modifications au regard du profil du président de la République.
- État des lieux des outils actuels de gouvernance
La formulation des suggestions commande au préalable un état des lieux du dispositif de gouvernance composé d’outils de pilotage de la performance. Vous avez compris, le parti pris ici est que le Président est élu pour améliorer les conditions de vie des populations à travers un programme politique qu’il a proposé. En effet, il convient de partir de l’existant pour envisager un renouvellement. Les principaux outils de pilotage de la performance sont issus de trois sources: les dispositifs transversaux et ministériels, les dispositifs opérationnels (instances de gouvernance), le dispositif de gouvernance des entités publiques et celui des collectivités territoriales décentralisées.
Les dispositifs transversaux et ministériels se réfèrent aux dispositions de la Constitution et du Régime financier de l’État (Rfe). La Constitution prévoit des dispositifs de pilotage suivants: le conseil des ministres, la délégation expresse du président de la République (Prc) au Premier ministre (Pm) ou aux membres du gouvernement, le conseil de cabinet, la délégation expresse du Pm aux membres du gouvernement ou aux hauts responsables de l’administration, les questions orales et écrites, les commissions d’enquête parlementaires, les audits et les audiences. Ces dispositifs génèrent des outils de pilotage: le compte rendu (du conseil de ministres et du conseil de cabinet), les actes de délégations expresses du PRC et du PM aux membres du gouvernement, des rapports, des arrêts et des plateformes web de reddition des comptes. Tous ces outils se réfèrent aux activités stratégiques d’orientation, de planification et de contrôle.
Il apparaît alors que les outils de mise en œuvre sont au niveau des départements ministériels, des entités publiques et des collectivités territoriales décentralisées. Le Rfe et les dispositifs de pilotage sont: les instructions, les arbitrages, réunions/ échanges d’informations, dialogue de gestion, examen documentaire. Ces dispositifs génèrent des outils de pilotage: lois de finances, décrets, arrêtés, comptes rendus, circulaires, Programme annuel de performance (Ppa), tableau de bord, contrôle de gestion, rapports d’activité, avis.
En ce qui concerne le dispositif opérationnel, il apparaît clairement que le pilotage de la performance des Ctd est assuré par le Mindevel; rien n’est expressément dit sur le pilotage de la performance de l’administration centrale et celle des entités publiques(3) (entreprises et établissements publics). On en déduit que ce pilotage devrait être directement assuré par le Pm; qui peut, par délégation expresse, confier cette responsabilité à des membres du gouvernement ou à de hauts responsables comme le prévoit la Constitution. Dans ces conditions, il conviendrait que les rapports d’évaluation de la performance des administrations (à travers les rapports annuels de performance) et ceux des entités publiques fassent l’objet d’évaluation et de sanction au niveau de la coordination gouvernementale (Pm) même si une délégation expresse a été faite par le PM.
Au niveau des entités publiques et des collectivités territoriales décentralisées, des lois spécifiques identifient les outils de pilotage en vigueur. En marge de ce qui précède, la place croissante du secrétariat général de la présidence de la République mérite d’être soulignée en tant qu’institution en charge du pilotage de la performance des administrations placées sous son giron. C’est elle qui soutient notre proposition d’aménagement d’un dispositif de pilotage de l’action gouvernementale.
- Une révision du dispositif de gouvernance à partir des prérogatives du SGPR

Suivant les articles 2 et 3 du décret no 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, le secrétariat général est chargé des relations entre la présidence de la République et le gouvernement. Il assure, en outre, la liaison entre l’exécutif et les différentes institutions républicaines, notamment l’assemblée nationale, le sénat, le conseil constitutionnel, la cour suprême, le conseil économique et social et le contrôle supérieur de l’État. Le secrétaire général assiste le président de la République dans l’accomplissement de sa mission.
L’élection 2025 est placée sous le signe de l’incertitude entretenue d’une part par les peurs et d’autre part par la nécessité d’un espoir reposant sur un dispositif de gouvernance adapté au profil générationnel du Président.
Dans l’exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une «délégation de signature». L’intérêt de l’examen des compétences du secrétariat général de la Présidence de la République réside dans l’attribution d’une compétence de coordination expresse des activités des administrations rattachées d’une part, et des services internes à la présidence de la République d’autre part.
S’agissant des administrations rattachées, l’article 37 en donne l’énumération ci-après. Sont rattachés au secrétariat général de la présidence de la République:
- – La Grande chancellerie des ordres nationaux;
- – Les services du contrôle supérieur de l’État;
- – Le ministère des Marchés publics;
- – La Délégation générale à la sûreté nationale, en ce qui concerne son administration;
- – La Direction générale à la recherche extérieure, en ce qui concerne son administration;
- – Le Programme de formation bilingue;
- – Le Conseil national de sécurité;
- – La Commission nationale anticorruption;
- – La Commission nationale des frontières;
- – Le Comité de suivi des grands projets.
Le secrétaire général de la présidence de la République est donc chargé du pilotage de la performance de l’ensemble des institutions dont il assure la coordination. Plus intéressante est la formulation de l’article 30 dudit décret qui dispose: «(1) Placé sous l’autorité d’un secrétaire assisté d’un adjoint, ayant respectivement rang de chargé de mission et de directeur, le secrétariat des conseils ministériels est chargé: – de la préparation des conseils ministériels, des conseils restreints, ainsi que de la diffusion des décisions prises au cours de ces réunions; – du suivi de l’exécution des directives données au cours de ces réunions, en liaison avec les structures internes compétentes. Il participe en outre à toutes les réunions interministérielles organisées par le secrétariat général de la présidence de la République. (2) Le secrétariat des conseils ministériels comprend, outre le secrétaire des conseils ministériels et son adjoint, trois chargés d’études».
La lecture de cette disposition, notamment la dernière particule de l’alinéa 1, laisse entrevoir l’attribution d’une compétence au secrétaire général de la présidence de la République de convoquer et d’organiser des réunions interministérielles. Cela dénote de la mise à disposition, au secrétaire général, d’un dispositif spécifique de pilotage de la performance des départements ministériels en ce qui concerne le suivi des activités déterminées. De même dans la pratique, du fait sans doute de la délégation expresse du Président au Sgpr, et à travers les «hautes instructions du chef de l’État», plusieurs activités relevant du pilotage de la performance de l’administration publique sont réalisées au Sgpr.
Cette duplication de coordination qui requiert en amont l’arbitrage du chef de l’État peut être revue pour laisser au Premier ministre et à lui seul la prérogative de la coordination de l’action gouvernementale avec une soumission de l’ensemble du gouvernement (à l’exception des structures relevant du judiciaire et du législatif) au Premier ministre. On envisagerait alors que les services ci-après rattachés à la présidence de la République rentrent dans le giron du Premier ministre (les services du contrôle supérieur de l’État, le ministère des Marchés publics, le Programme de formation bilingue, la Commission nationale anticorruption, le Comité de suivi des grands projets). À l’évidence, une réorganisation du gouvernement et une rationalisation des programmes et projets rattachés au Pm seraient nécessaires.
Au même moment, le Sgpr assurerait alors exclusivement les autres actions stratégiques de la Prc. Il agirait alors comme un «véritable adjoint». Il devra alors s’assurer de l’adhésion du Pm et de l’adhésion de tous les membres du gouvernement. Le Président devrait alors au moins envoyer des signaux clairs plus que par le passé de ce qu’il détient les manettes de toute cette organisation. C’est à ce prix que cette proposition peut être valable.
Pour conclure, l’élection 2025 est placée sous le signe de l’incertitude entretenue d’une part par les peurs et d’autre part par la nécessité d’un espoir reposant sur un dispositif de gouvernance adapté au profil générationnel du Président, dont le contenu devrait permettre de rendre la gouvernance du pays viable. L’intérêt de la présente analyse est de s’appuyer sur les fortes probabilités de victoire du président de la République pour proposer des aménagements dans le dispositif de gouvernance actuel.
Les propositions faites présentent les limites liées aux contraintes actuelles du contexte: des suggestions à très court terme qui devraient permettre de préparer la transition, la nécessité de poursuivre, au même moment, l’exécution des réformes structurelles déjà engagées. Les propositions à moyen terme pourront faire l’objet d’une analyse ultérieure. L’analyse ici présente la limite d’être faite à réalité constante. Quel que soit le bout par lequel on souhaiterait faire l’analyse, c’est un septennat qui s’annonce extrêmement difficile.
Par Pr Viviane Ondoua Biwolé. Experte en gouvernance.
- (1) C’est sans doute l’origine de la grande inertie (inertie structurelle, bureaucratique, politique et culturelle) qui est reprochée aux administrations publiques en plus du comportement opportuniste des agents publics.
- (2) Le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (Dsrp), premier document de stratégie élaboré après la crise et après les Programmes d’ajustement structurel.
- (3) Bien que les textes prévoient de transmettre les rapports de performance des entreprises et établissements publics à la présidence, il est difficile de savoir quelle est l’instance à même de coordonner la performance des entités publiques à la présidence.
Source : Lignes d’horizon 19 N°052 – Juillet 2025
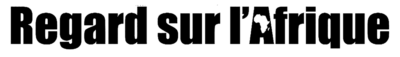





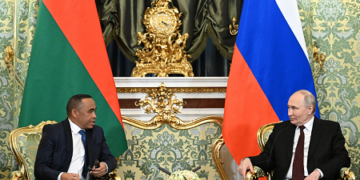


































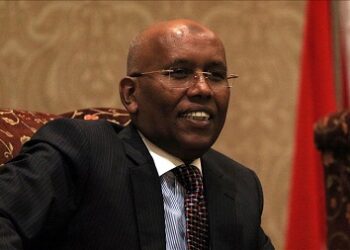










Discussion à propos du post