La résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025, fixe clairement l’autonomie sous souveraineté marocaine comme base des négociations sur le Sahara et somme l’Algérie d’y participer. Groggy, Alger reste silencieuse sur son engagement, ou non, évitant d’assumer ses responsabilités dans un processus désormais contraignant et juridiquement obligatoire. Quelle posture choisira finalement le voisin face à un Conseil de sécurité déterminé? Éléments de réponses.
Il a d’abord dit non, allant jusqu’à refuser de voter la résolution. Puis il a pratiquement dit oui, prétextant que finalement, c’est un succès pour sa diplomatie, lui qui a réussi à «faire barrage» à une première mouture complètement en faveur de son ennemi juré. Puis il a encore dit non, mobilisant son proxy pour affirmer qu’il ne fera pas partie de la suite, pour encore suggérer un oui et qu’à un détail près, «il a même failli voter le texte onusien», guettant au passage le moindre petit commentaire de l’administration du pen holder, les États-Unis, pour se donner raison. Bref, un vaudeville politique que même les meilleurs dramaturges n’oseraient imaginer.
C’est en résumé l’attitude puérile observée par le régime d’Alger quant à l’historique résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025 et qui consacre définitivement le plan d’autonomie comme la solution au conflit sur le Sahara. Ce que le voisin ne dit pas, et c’est là où il est attendu par la communauté internationale, c’est, oui ou non, il allait prendre ses responsabilités et participer aux négociations à venir, sur la base de l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.
Dans sa résolution du vendredi dernier, le Conseil de sécurité n’y va pas par quatre chemins. Les quatre parties au conflit, nommément citées (le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario) sont sommées de s’asseoir sur la même table des négociations, avec pour menu… le plan marocain. Les mots sont d’une précision chirurgicale. Le Conseil de sécurité stipule que les parties doivent «participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive».
Lors de sa première réaction officielle, l’envoyé personnel du secrétaire général au Sahara n’a fait ni plus ni moins que répéter le message. Le mandat que lui a confié le Conseil de sécurité est clair: conduire les négociations sur la base du plan marocain. «Nous prendrons bien sûr, comme indiqué dans la résolution 2797, le plan d’autonomie marocain de 2007 comme base de ces négociations», a-t-il rappelé lors d’un point de presse le mercredi 5 novembre dernier.
Le moment le plus révélateur de ce point de presse est survenu lorsqu’un journaliste palestinien, accrédité à l’ONU et notoirement proche du régime d’Alger, a osé parler de «deux parties au conflit». De Mistura l’a corrigé avec une fermeté qui ne souffre aucune contestation. «Les parties sont désormais clairement identifiées: le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie», a-t-il précisé. Une manière élégante de rappeler que la diplomatie, ce n’est pas un terrain de jeu pour ceux qui veulent tricher avec la réalité.
Ainsi engagée, l’Algérie n’a, étonnamment, toujours pas réagi à la sommation. À peine avons-nous eu droit à une poussée de fièvre de son verbeux représentant à l’ONU, Amar Bendjama, le jour de l’adoption du texte. Ce dernier a (un peu trop) longuement expliqué sa non-participation au vote, critiquant un texte «qui ne reflète pas la doctrine onusienne en matière de décolonisation», «un cadre étriqué de négociation qui met nettement en exergue les ambitions territoriales d’une partie au différend» et allant même jusqu’à parler d’une résolution qui «suscite les interrogations juridiques les plus sérieuses».
L’incompétent M. Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, aura, lui, brillé par le vide sidéral de sa réaction télévisée au texte. Ceci, en répondant mardi 2 novembre dans une interview déguisée diffusée sur AL24 News, le dernier-né des médias propagandistes directement rattaché à la présidence algérienne, par le mensonge et le déni, histoire de faire croire que la réalité onusienne n’existe pas. Un numéro qui frôle le ridicule, mais qu’Alger semble prendre très au sérieux.
Le verbe incertain, la mine déconfite, Attaf s’est livré à un exercice qui ressemblait à une séance de torture. Entre mensonge et déni, il a sciemment omis l’essentiel: l’autonomie a été consacrée dans la résolution 2797 comme base au règlement définitif du différend créé autour du Sahara. Et cela engage son pays.
Au lieu d’aller à l’essentiel et dire quelle sera l’attitude de son pays, le «diplomate» ressuscite les morts en affirmant… que son pays a demandé la suppression de la disposition mentionnant la souveraineté marocaine dans le préambule de la résolution, et qu’en contrepartie l’Algérie voterait en faveur du texte. «Elle n’a pas été enlevée. C’est pour cela que l’Algérie n’a pas participé au vote», a-t-il encore menti. Une gymnastique verbale qui ferait passer un funambule pour un amateur, mais qui, chez Attaf, semble constituer la seule stratégie diplomatique dont il se targue.
Pour des résolutions bien moins graves pour le duo Algérie-Polisario, le régime d’Alger nous a franchement habitués à mieux. L’année dernière déjà, l’Algérie avait refusé de participer au vote de la résolution sur le Sahara, alors que le texte de 2024 ne mentionnait même pas la «souveraineté marocaine». Et jusqu’ici, le pays était prompt à déployer sa logorrhée verbale pour dénoncer les résolutions onusiennes sur le Sahara et affirmer qu’il ne s’y inscrivait pas.
Cette posture s’est répétée non pas une, ni deux, mais trois fois. En 2020, lors de l’adoption de la résolution 2548 du Conseil de sécurité, le 31 octobre 2020, l’Algérie «prend acte» du texte, tout en regrettant son contenu, qu’elle qualifie de déséquilibré, reprochant qu’il «ne préconise aucune mesure concrète…». L’année suivante, le 29 octobre 2021, la résolution 2602 suscite de la part de l’Algérie un communiqué officiel affirmant qu’elle «ne soutiendra pas cette résolution», qu’elle juge «partiale» et «déséquilibrée». En 2022, la résolution 2654, adoptée le 27 octobre, provoque un nouveau communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, qualifiant le texte de «résultat d’un exercice laborieux de rédaction» dépourvu, selon elle, de toute volonté réelle de régler la question.
Avant 2025, chaque résolution est l’occasion d’un petit festival de critiques. À chaque fois, l’Algérie en profitait pour marteler qu’elle ne participera pas au processus onusien des tables rondes auquel elle était convoquée. En octobre 2021, le pays a formellement annoncé son «rejet» du «format de table-ronde» de négociations proposé par les Nations Unies. L’année suivante, en septembre 2022, l’Algérie a de nouveau décliné une invitation à participer aux tables rondes quadripartites, estimant ne pas être «partie prenante».
Aujourd’hui, maintenant qu’elle est nommément sommée de participer aux prochaines étapes, que va faire l’Algérie? Pour l’heure, et en dehors de quelques tentatives de parasitages et de prises de parole relevant du verbiage, aucune décision n’a encore été annoncée. Une fois de plus, Alger joue l’immobilisme avec la subtilité d’un éléphant dans un magasin de porcelaine diplomatique.
Compte à rebours
Or, clairement désignée comme partie prenante, l’Algérie se doit de répondre aux exigences du Conseil de sécurité. L’article 25 de la Charte des Nations unies n’est pas seulement clair. Il est contraignant. «Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte». Autrement dit, les décisions du Conseil ont un caractère obligatoire et une valeur juridique contraignante. «Si ces décisions sont contraignantes pour les États membres, elles le sont a fortiori et encore plus pour les membres du Conseil. Et une non-participation au vote d’une décision ne saurait exonérer un membre de ce Conseil de la responsabilité d’honorer cette obligation»,écrit, dans un policy paper dédié, Mohammed Loulichki, ancien ambassadeur-représentant du Maroc à l’ONU, aujourd’hui Senior fellow au Policy center for the new south (PCNS), spécialiste en diplomatie et résolution des conflits.
Rappelons que l’Algérie a refusé de prendre part aux deux votes sur le Sahara durant les deux années où elle a siégé en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, en 2024 et 2025. Le 31 décembre prochain, elle cédera sa place à un autre pays au Conseil. Elle ne sera pas présente non plus à la réunion «stratégique» d’avril 2026, où l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, informera les membres du Conseil de l’état d’avancement des pourparlers entre le Maroc, l’Algérie, le Polisario et la Mauritanie, sur la base de l’autonomie comme solution au différend du Sahara. Autant dire que le compte à rebours est enclenché pendant que l’Algérie continue de jouer l’absente dans un théâtre où elle tient pourtant le rôle de protagoniste, esquivant ses obligations comme un enfant refusant de finir son assiette. Jusqu’à quand.
Jusqu’ici, la question du Sahara obéissait aux normes fixées par le chapitre VI de la Charte des Nations Unies. Ce chapitre concerne les moyens par lesquels les États membres doivent résoudre leurs conflits de manière pacifique. Il souligne que les États doivent d’abord chercher à régler leurs différends par la négociation, la médiation, l’arbitrage, ou d’autres moyens pacifiques, avant de recourir à la force. Ce chapitre donne également au Conseil de sécurité le rôle de faciliter ces résolutions et de recommander des solutions, mais sans imposer directement de sanctions ou d’actions coercitives. L’objectif principal est de prévenir les conflits et de maintenir la paix internationale par le dialogue et la coopération.
Dans cet esprit, et depuis la création de la MINURSO en 1991, les résolutions du Conseil se contentaient de renouveler chaque année le mandat de la MINURSO, encourager les parties à poursuivre les négociations «de bonne foi», appeler à une solution politique «juste, durable et mutuellement acceptable», et soutenir les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général. Ces termes sont typiques des résolutions adoptées sous le Chapitre VI. Polies, diplomatiques, presque prudentes.
Mais doucement, la doctrine est en train de glisser, et ce, vers les dispositions de l’article VII de la même Charte. Et c’est là que les choses se corsent pour l’Algérie. En exhortant les parties à négocier, le Conseil de sécurité cesse de simplement suggérer. Il oblige. Et c’est à ce moment que des mesures de coercition, voire des sanctions, peuvent entrer en jeu. Le chapitre VII, intitulé «Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression», donne au Conseil de sécurité le pouvoir d’intervenir lorsque la paix internationale est menacée. Contrairement au chapitre VI, il autorise des mesures coercitives, allant des sanctions économiques et politiques jusqu’au recours à la force militaire, pour faire respecter la paix et la sécurité. Ce chapitre établit que le Conseil peut décider des actions nécessaires, y compris des opérations militaires, afin de protéger ou rétablir la stabilité. L’objectif est de permettre une réaction efficace face aux conflits graves qui mettent en danger la communauté internationale.
«Avec un Polisario, que beaucoup savent instrumentalisé par l’Algérie, menaçant de répondre par les armes, le risque devient tangible. La milice armée se retrouve d’autant plus sous le coup d’une proposition de loi américaine visant à la classer comme organisation terroriste. De là à ce que l’Algérie elle-même soit cataloguée comme pays sponsor du terrorisme, il n’y a qu’un pas», souligne Abdelfattah Naoum, politologue, expert en relations internationales et spécialiste du dossier du Sahara. Un pas qu’Alger redoute manifestement.
La non-réaction officielle de l’Algérie à la sommation du Conseil de sécurité traduit ainsi une peur bleue de ce scénario. Mais une chose est certaine. Alger ne peut plus se permettre le luxe de snober le processus onusien. Plus tôt que tard, elle devra se résigner à respecter la sommation du Conseil de sécurité, qu’elle le veuille ou non.
RSA Par Tarik Qattab
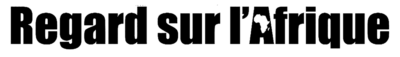












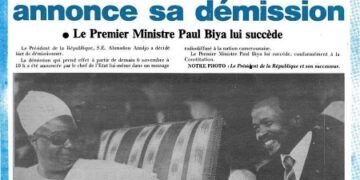








































Discussion à propos du post