Définir les inégalités est une opération complexe et un exercice rarement pratiqué, ce qui est assez étonnant vu l’ampleur du débat sur ce sujet. Le dictionnaire nous dit qu’ « une inégalité est ce qui n’est pas égal ». Et qu’une égalité est ce qui est uni, de même niveau. « Semblable en nature, en quantité, en qualité, en valeur ». On reste sur sa faim.
À l’Observatoire des inégalités, je propose la définition suivante : on peut parler d’inégalités « quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés », sous-entendu « et qu’une partie des autres ne détient pas ».
Les inégalités occupent le débat public, mais de quoi parle-t-on au juste ?
D’abord, pour parler d’inégalités, il faut que l’accès aux biens, aux services ou aux pratiques puisse se classer, être valorisé de façon hiérarchique ; sinon, il ne s’agit plus d’inégalités, mais de différences. Une différence ne devient une « inégalité » que lorsque ce dont on parle peut être hiérarchisé. On peut décomposer la question des inégalités en deux : « des inégalités de quoi ? » et « des inégalités entre qui et qui ? ». « De quoi ? » : la question des inégalités, souvent réduite aux revenus, est bien plus large que cela. Elle s’étend de l’éducation à l’emploi, à la politique en passant par la santé et les loisirs, etc. Je vais appeler ces champs des « domaines ». Ces derniers permettent de décrire le fonctionnement de la vie en société. Selon ses valeurs, ses préoccupations, chacun accordera un intérêt plus ou moins grand à tel ou tel de ces domaines.
La politique possible pour tous
Au Cameroun, les citoyens ne sont pas égaux face à la politique. Tout d’abord, il existe une inégalité en termes de participation : les ouvriers et les employés, qui sont aussi les moins diplômés et les moins riches, sont de moins en moins présents dans les partis politiques et votent de moins en moins. Trop souvent, l’abstention est expliquée sous le prisme moral, comme un manque de civisme. Cette explication ne tient pas la route longtemps. Certains enquêtes montrent que les Camerounais sont très loin d’être indifférents aux affaires publiques. En revanche, ils ressentent de plus en plus de défiance envers leurs institutions et la classe politique dans son ensemble. Les inégalités sociales face à la politique sont considérables.
Démocratiser l’accès à la vie politique
Il est d’ailleurs logique que la moitié la moins favorisée de la population soit la plus réticente à participer au jeu électoral : les ouvriers et les employés sont ceux qui ont le plus perdu des politiques menées depuis trente huit ans par un seul parti (RDPC), avec à sa tête le président Paul Biya et son partenaire Ni John Fru Ndi du Social democracy front (SDF), aussi l’Union nationale pour la démocratie et le progrès au Cameroun (UNDPC) de Bello Bouba Maigari, qui ont organisé une redistribution des richesses du bas vers le haut. Cela a sans doute à voir avec le fait que les principaux bénéficiaires de ces politiques sont aussi les plus représentés dans nos institutions.
L’inégalité de représentation dans la vie politique signifie que, selon votre milieu social, vous ne serez pas représenté de la même manière dans les instances décisionnelles de la République. Les classes supérieures sont très largement présentes parmi les élus et la classe politique au sens large : 90 % des députés sont cadres et professions intellectuelles supérieures alors que seulement 10% d’entre eux sont ouvriers ou employés (sachant que cette catégorie sociale regroupe plus de la moitié de la population camerounaise !).
À l’Observatoire des inégalités, j’ai retenu cinq principaux : « revenus », « éducation », « emploi », « lien social et politique » et « conditions de vie ». Celles-ci qui devraient évoluer pour mettre fin à la défiance populaire dont elles sont l’objet.
Trop souvent, l’abstention est expliquée sous le prisme moral, comme un manque de civisme. Cette explication ne tient pas la route longtemps.
Réformer les institutions
Du côté institutionnel, on peut réduire les inégalités face à la politique en cessant tout d’abord de croire aveuglément en la démocratie représentative : quand la grande majorité des élus sont de classes supérieures, il est hasardeux de penser que ces derniers peuvent représenter les intérêts de toute la population. Partant de ce constat, il faut faire en sorte que les citoyens puissent prendre part à la décision publique sans déléguer entièrement leur pouvoir à des élus qui les représentent de moins en moins. Cela implique de vraies mesures, et pas des assemblages.
La « démocratie participative » telle qu’elle est dénommée sera une perte de légitimité des élus qui en profitent de leurs positions pour nuire aux populations. Afin d’être réellement démocratiques, les mesures d’implication des citoyens doivent être contraignantes et décisionnelles. Alors pour briser ces logiques, il faut renouveler la classe politique et en démocratiser l’accès. Il faudrait, pour commencer, que les mêmes ne monopolisent pas les mandats sur la durée. Il faut absolument en interdire une bonne fois pour toute le cumul, mais aussi limiter le nombre de mandats possible. Ensuite, il est impératif de reconditionner le versement des indemnités.
Tinno Bang MBANG, DP du magazine panafricain Regard Sur l’Afrique
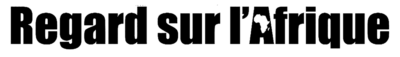






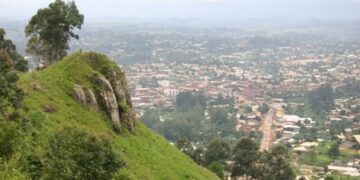



































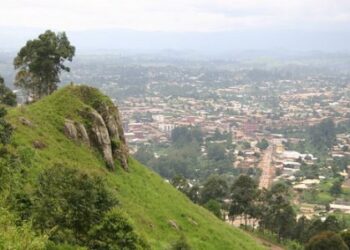










Discussion à propos du post