Royaume-Uni-Afrique | Boris Johnson veut s’assurer de nouveaux marchés

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait rencontré le lundi 20 janvier 2020, à Londres, à quelques jours du Brexit, qui signifia la sortie du Grande-Bretagne de l’UE. Hôte de ce sommet, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait plaidé pour que la Grande-Bretagne soit « un investisseur de choix » pour les pays africains. Vingt-et-un pays africains étaient représentés dont seize par leurs chefs d’État.
Des chefs d’État venus d’Afrique anglophone et francophone tels que le Nigérian Muhammadu Buhari, le Rwandais Paul Kagamé, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et de Guinée Conakry, Alpha Condé… Ils étaient seize à avoir fait le déplacement pour Londres.
Au centre de ces discussions: les investissements et les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Afrique. Londres avait alors annoncé des accords commerciaux pour plus de 7 milliards et demi d’euros, entre entreprises britanniques et africaines.
Le Premier ministre britannique avait évoqué l’immigration et la lutte contre le changement climatique. Boris Johnson a affirmé que la Grande-Bretagne sera plus ouverte aux migrants africains, après le Brexit.
Il avait promis aussi que son pays n’investira plus dans l’extraction de charbon ou dans sa combustion, pour produire de l’électricité sur le continent, mais se concentrera sur une transition vers des alternatives faibles en carbone.
Le Royaume-Uni est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux, alors que le Brexit, qui a pris fin le 31 janvier, a mis fin à 47 ans de vie commune et d’échanges privilégiés avec l’Union Européenne.
Devant les dirigeants des 21 pays représentés, Boris Johnson avait plaidé pour que le Royaume-Uni devienne l’« investisseur de choix » des pays africains, le communiqué de Downing Street promettant l’annonce de plusieurs « accords valant des milliards de livres ».
Allemagne : Angela Merkel en Afrique, une tournée sous le signe de l’économie

La presse allemande évoquait le décès de l’ancien président kenyan Daniel Arap Moi, mais également la tournée africaine de la chancelière allemande Angela Merkel du 5 au 8 février un voyage de trois jours en Afrique du Sud et en Angola
Afrique du Sud et Angola sont les deux étapes de la tournée africaine d’Angela Merkel.
Der Tagesspiegel, qui s’intéresse à l’étape sud-africaine de ce déplacement, revient sur la rencontre entre Angela Merkel et le président Cyril Ramaphosa qui, selon le quotidien, espère des investissements allemands pour son pays.
Der Tagesspiegel rappelle que Cyril Ramaphosa a hérité d’un pays qui doit faire face à d’énormes difficultés comme par exemple l’approvisionnement en énergie.
Le fournisseur d’énergie public Eskom doit en effet procéder régulièrement à des coupures d’électricité pour que le réseau ne s’effondre pas. L’Afrique du Sud essaie progressivement de passer aux énergies renouvelables et l’Allemagne peut y contribuer, peut-on lire dans le Tagesspiegel qui écrit également que les constructeurs automobiles sont un grand espoir pour Ramaphosa qui plaide pour plus d’investissements.
Tout en revenant sur l’aspect économique de ce déplacement d’Angela Merkel, la Frankfurter Rundschau souligne de son côté qu’en Afrique, la chancelière est une héroïne. Notamment pour avoir ouvert les frontières allemandes aux réfugiés en 2015.Mais le quotidien évoque également l’étape angolaise de la tournée. Une étape dominée aussi par les questions d’ordre économique mais également la lutte contre la corruption. Un fléau qui, avec le non-respect de l’Etat de droit, sont considérés comme des freins aux investissements allemands en Angola, selon la FrankfurterRundschau.
Melanie Müller, spécialiste de l’Afrique du Sud à la Fondation allemande de sciences politiques (SWP), basée à Berlin, explique ce changement par la volonté de restaurer l’image du pays.
« Le pays et le nouveau président ont très bien compris que la réputation de l’Afrique du Sud a souffert pendant la présidence de Jacob Zuma. L’Afrique du Sud a perdu sa réputation très clairement, dans des domaines très différents. Elle a toujours été un acteur important en matière de démocratie et de droits de l’homme et c’est un partenaire économique important pour l’Allemagne en Afrique subsaharienne. »
Dans le domaine de la coopération au développement, un partenariat énergétique bilatéral est en place, en plus de coopérations en matière de formation professionnelle.
Enfin, les relations économiques entre Berlin et Pretoria sont florissantes. C’est ce qu’explique Matthias Boddenberg de la Chambre allemande du commerce extérieur pour l’Afrique australe.
Arap Moi, icône ou dictateur?
Les journaux allemands commentent également le décès, cette semaine, de l’ancien président du Kenya Daniel Arap Moi. A ce sujet, la SüddeutscheZeitung écrit que l’actuel président Uhuru Kenyatta l’a qualifié d ‘ »icône africaine ». Mais pour de nombreux Africains, il était également autocrate et populiste.
Der Spiegel retrace le parcours politique de l’ex-chef d’Etat décédé à l’âge de 95 ans. Selon le journal, son mandat de 24 ans qui avait bien commencé s’est par la suite illustré par des violations des droits de l’homme et la centralisation du pouvoir.
Der Spiegel rappelle également que récemment, Moi a fait la une des journaux en raison d’un différend foncier. Il avait été condamné à payer 1,6 milliard de shillings (environ 9,2 millions d’euros) à une famille d’Eldoret dans l’ouest du pays qui l’avait accusé d’avoir illégalement pris possession d’une propriété de 53 hectares en 1983. Un jugement qui selon le quotidien a envoyé un signal important.
« Le dernier dictateur du Kenya« , c’est ainsi que Die Tageszeitung titre son article sur l’ancien président. Tout en rappelant les dérives sous sa présidence, la TAZ précise toutefois qu’après sa mort, les Kényans indulgents se souviennent que Moi a réussi à maintenir la paix entre 1978 et 2002 – alors qu’il y avait des guerres civiles dans d’autres pays d’Afrique de l’Est, comme l’Ouganda, la Somalie, le Soudan et l’Éthiopie.
Comment les Chinois mènent la conquête de l’Afrique

L’argent chinois coule à flots sur le continent africain, ce qui ne manque pas d’alarmer les institutions internationales et les pays occidentaux. D’autant plus au regard de l’opacité et des pratiques de la Chine.
C’est sur la place Tiananmen, face à la Cité interdite, d’immenses parterres de fleurs jaunes et violettes s’étalent devant le Grand Hall du Peuple. A Pékin, le 3 septembre 2018, l’immense structure de béton, lieu traditionnel de rassemblement des élus du Parti communiste chinois, accueillait pendant deux jours le Forum Chine-Afrique. A l’intérieur, l’immense hémicycle rassemble des milliers de délégués des deux continents venus écouter le discours d’ouverture du président chinois, Xi Jinping.
Les leaders africains étaient tous là, excepté le monarque du Swaziland. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, l’Ivoirien Alassane Ouattara, le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Kenyan Uhuru Kenyatta ou encore le Sénégalais Macky Sall et le président du Rwanda, Paul Kagame, avaient été reçus en grande pompe à leur descente d’avion, à l’aéroport de Pékin. Inauguré en 2000, le Forum Chine-Afrique en est déjà à sa huitième édition. Les 53 leaders africains écoutent solennellement Xi Jinping leur vanter la grande famille sino-africaine et se réjouissent des milliards de dollars d’investissements qu’il leur promet.
Le discours de Xi Jinping aux Africains
Pékin met sur la table 60 milliards de dollars de plus pour le développement économique des Etats africains. De cette somme globale, 15 milliards de dollars financeront des programmes « d’aide gratuite et de prêts sans intérêts », souligne Xi Jinping. La précision est d’importance quand la Chine, premier partenaire commercial de l’Afrique, est accusée d’entraîner à nouveau l’Afrique sur la voie du surendettement.
Surendettement, le retour
Les dirigeants occidentaux, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et les ONG montent d’ailleurs au créneau. Durant les années 1980 et 1990, les politiques d’effacement de dettes engagées par les pays riches, sous l’égide des deux institutions multilatérales, ont permis des progrès substantiels : d’un ratio de près de 100 % du PIB, l’endettement des pays les plus pauvres avait été ramené à 30 % en 2013.
Or nous sommes revenus à 50 % en 2017, a alerté en janvier dernier la Banque mondiale . Le FMI pointe quant à lui le fait que 40 % des pays à faible revenu (24 sur 60) , africains essentiellement, présentent un degré élevé de surendettement. L’Afrique risque de tomber de Charybde en Scylla. Et le coupable n’est autre cette fois que la Chine, source croissante de financement pour l’Afrique, dont les méthodes s’avèrent pour le moins douteuses.
La Chine ne fait pas partie du Club de Paris ni du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Il est difficile de savoir très précisément ce qu’elle réalise réellement en Afrique
En matière de statistiques, les chiffres avancés par le FMI et la Banque mondiale ne peuvent rendre compte de l’exacte situation. « La Chine ne fait pas partie du Club de Paris ni du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Il est difficile de savoir très précisément ce qu’elle réalise réellement en Afrique. Bien souvent, Pékin se retranche derrière le secret d’Etat pour ne pas divulguer ces chiffres », observe Bradley Parks, directeur exécutif de AidData. Ce centre de recherche, basé au sein du Collège de William et Mary, en Virginie (Etats-Unis), a pourtant élaboré une vaste base de données sur les financements à l’étranger de la Chine sur la période 2000-2014 .
L’Afrique est au cœur des projets d’investissements chinois à l’étranger. AidData
« Nous avons rassemblé les statistiques officielles du FMI, de la Banque mondiale, analysé leurs rapports économiques sur chaque pays, consulté les sites Web des différents gouvernements, analysé les prospectus publiés lors d’une émission obligataire d’un pays ou d’une entreprise », détaille-t-il. Au total, sur la période analysée, les financements chinois en faveur de l’Afrique ont atteint, selon AidData, 121,6 milliards de dollars – contre une aide américaine de 106,7 milliards de dollars. La Johns Hopkins University, via son projet de recherche Cari (China Africa Research Initiative), avance même le chiffre de 143 milliards de dollars de prêts des institutions publiques et des banques chinoises aux gouvernements africains entre 2000 et 2007.
Aide ou prêts ?
En Afrique subsaharienne, recense AidData, la Chine a notamment financé un boulevard périphérique de 320 millions de dollars autour d’Addis-Abeba, une ligne ferroviaire à 3 milliards de dollars entre Addis-Abeba et le port balnéaire de Doraleh, à Djibouti, une autre ligne à 4 milliards de dollars entre Nairobi et le port de Mombasa ou encore une route à 600 millions de dollars entre Port-Gentil et Libreville, au Gabon. L’argent chinois coule à flots mais pas pour des raisons d’aide publique au développement.
États-Unis : Donald Trump « L’Afrique doit être recolonisée »

En 2016, le président américain, Donald Trump, nouvellement éllu insultait les africains. Il faisait donc comprendre au monde que « l’Afrique devrait être recolonisée ».
« Les Africains sont des esclaves qui vivent comme des esclaves dans leur propre pays » indique Donald Trump. Et pourtant, rappellait-il, ces africains prétendaient être indépendants.
En face d’un journaliste sud-africain, le président élu des américains n’avait pas été tendre à l’endroit des africains. C’était sur l’affaire de retrait de certains pays africains de la Cour Pénale Internationale (CPI). « Il est honteux pour les dirigeants africains de chercher la sortie de la CPI » lançait-il.
Pour Donald Trump, ces dirigeants veulent simplement avoir toute la liberté d’opprimer leurs pauvres peuples. Ils veulent que personne ne leur pose de questions. « Je pense qu’il n’y a pas de raccourci vers la maturité. L’Afrique devrait être colonisée parce que les africains sont encore sous esclavage » avait fulminé
Trmp invitait les gens à regarder ces leaders africains qui changent les institutions en leur faveur. Ce, pour qu’ils puissent être des présidents. « Ils sont trop gourmands et ne se soucient pas du peuple » avait alors déclaré.
« Les dirigeants africains peuvent même pas trouver une solution amiable pour le dilemme permanent au Burundi et ailleurs », dit-il. Selon Donald Trump, ils veulent seulement se retirer d’une cour qui les aide.
« Ces gens manquent de discipline et de cœur humain. Ils ne peuvent pas donner l’exemple » fait-il remarquer. Selon lui, ce qui les intéresse est d’accumuler la richesse des contribuables.
Donald Trump et l’Afrique : quatre années de perdues
Le 8 novembre 2016, le paysage politique américain subissait un véritable séisme politique avec l’élection de Donald Trump, candidat républicain donné perdant par la plupart des sondages. Près de quatre ans après son élection, les effets de la nouvelle politique étrangère promue par le chef de file du « America First » se sont fait ressentir dans tous les pays, en particulier ceux du continent africain.
Des échanges commerciaux faibles
Avant l’arrivée de Donald Trump, les relations commerciales américano-africaines étaient déjà à un niveau jugé assez faible par rapport à d’autres pays. Depuis le pic de 141,8 milliards $ atteint en 2008, les échanges de biens entre l’Afrique et les Etats-Unis n’ont franchi la barre des 100 milliards $ que deux fois (113,3 milliards $ en 2010 et 125 milliards $ en 2011) sous le premier mandat du président Barack Obama, selon les chiffres du Bureau américain des recensements. Depuis lors, ils ont continué à chuter.
Alors que la résilience de la croissance africaine et son futur marché unique ont poussé les plus grandes puissances mondiales à booster leurs échanges commerciaux avec le continent, cette tendance ne semble pas être partagée par les Etats-Unis. En 2019, les échanges de biens entre Washington et les pays africains étaient estimés à 56,8 milliards $, soit une baisse de 8,07% par rapport aux 61,8 milliards $ estimés en 2018. A titre comparatif, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont grimpé de 2,2% en 2019 pour atteindre 208,7 milliards $.
En 2019, les échanges de biens entre Washington et les pays africains étaient estimés à 56,8 milliards $, en baisse de 8,07%. A titre comparatif, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont grimpé de 2,2% en 2019 pour atteindre 208,7 milliards $.
D’après le ministère américain du Commerce, en 2018, tous les pays d’Afrique subsaharienne réunis ne pesaient que 1% des exportations américaines, et également 1% des importations. Même si l’Afrique occupe une part marginale dans les échanges commerciaux américains, de nombreuses initiatives telles que l’African Growth Opportunity Act (AGOA) ont permis d’enregistrer des progrès sensibles depuis 2001. Toutefois, la récente utilisation par Donald Trump de cet accord comme moyen de pression sur des Etats africains ne semble pas propice au développement des échanges commerciaux entre les deux parties.
En 2015 par exemple, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie, dans une logique de protection de leur marché intérieur, se sont mis d’accord pour augmenter les taxes sur les fripes en provenance des États-Unis. Cette décision avait poussé l’administration Trump, sous l’influence de l’Association américaine de textiles d’occasion et recyclés (Smart), qui dénonçait l’imposition de droits de douane sur les exportations américaines, à exercer des pressions sur ces pays pour la réouverture de leurs marchés. Seul le Rwanda avait maintenu jusqu’au bout sa décision ; ce qui avait entraîné une suspension de ses avantages commerciaux relatifs aux exportations de vêtements vers les États-Unis. Plus récemment, c’est le Cameroun qui était exclu de l’AGOA, Washington accusant les forces armées camerounaises d’atteintes aux droits humains.
Une coopération sécuritaire de moins en moins certaine…
Si les relations commerciales USA-Afrique n’ont pas atteint un niveau assez suffisant pour faire de Washington un partenaire incontournable du continent noir, il n’en est pas de même en matière de coopération sécuritaire.
Au cours des dernières années, les Etats-Unis sont devenus un acteur important en matière de fourniture d’armement aux Etats et de lutte contre le terrorisme en Afrique.
Au cours des dernières années, les Etats-Unis sont devenus un acteur important en matière de fourniture d’armement aux Etats et de lutte contre le terrorisme en Afrique.
D’ailleurs, à son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump indiquait que l’un des axes prioritaires de sa politique étrangère serait la lutte contre le « terrorisme islamique radical ». Pourtant les déclarations faites ces derniers mois semblent remettre en question cette stratégie, au point de représenter, pour certains observateurs, une menace à terme pour la coopération sécuritaire américano-africaine sur le continent.
Fin décembre 2019, les autorités américaines annonçaient leur intention de réduire leurs effectifs en Afrique pour renforcer leurs positions en Asie.
Il faut noter qu’entre 6000 et 7000 soldats américains sont actuellement présents en Afrique. Si ce nombre reste modeste, le rôle de ces hommes est assez crucial, notamment en Afrique de l’Ouest où le terrorisme et les violences intercommunautaires ne cessent de croître depuis 2013.
le président Trump n’a encore effectué aucun déplacement dans une Afrique qui est presque annuellement à l’agenda de son homologue chinois, et de plus en plus de ses homologues français, allemand et même israélien. Si la situation perdure jusqu’à la fin de l’année, le chef d’Etat deviendra le premier président américain, depuis 20 ans, à ne pas visiter l’Afrique pendant son premier mandat.
Le grand retour de la Russie en Afrique

L’influence soviétique en Afrique
C’est après la Seconde Guerre Mondiale, alors que le monde est divisé entre le bloc soviétique et le bloc occidental, que l’onde de choc de la Révolution d’Octobre arrive sur les côtes africaines. Dans les années 1950 et 1960, la plupart des États du continent obtiennent leur indépendance des puissances coloniales, l’URSS défend alors les mouvements de libération nationale sur le continent. A cette époque, le puissant pays communiste considère les nations du « tiers-monde » comme des alliés potentiels contre l’Occident et peu de pays africains restent hermétiques aux idées portées par l’Union Soviétique, qu’ils choisissent comme alliée et alternative politique.
L’URSS déploie alors un contigent de conseillers dans plus de 40 pays : entre 1970 et 1975, ils seront plus de 40.000 en Afrique. L’Union soviétique signera également un accord pour la venue de nombreux étudiants africains sur son territoire.
On a beaucoup de mal à le concevoir aujourd’hui, mais en ces années 1975-1980, beaucoup à Paris et même à Washington se demandent si les héritiers de la Révolution de 1917 ne sont pas en train de prendre le contrôle de ce qu’on appelait à l’époque le Tiers-Monde et de faire tomber l’Occident. Christophe Boisbouvier sur JA
Le bilan de l’ère soviétique en Afrique est toutefois considéré comme mitigé par de nombreux spécialistes. Des séries d’évènements ébranlent l’influence de l’URSS sur le continent : assassinats d’hommes politiques qu’elle soutenait, comme Patrice Lumumba d’abord renversé par Mobutu Sese Sekjo, avant d’être tué, expulsions de conseillers soviétiques par l’Egyptien Anouar el-Sadate…
Le retour 30 ans après : les contrats remplacent l’idéologie
L’effondrement de l’Union soviétique, les difficultés économiques et les problèmes internes d’une Russie en plein chaos auront raison de ces alliances et partenariats. Les années 1990 marquent un tournant et la fin précipitée de l’influence russe sur le continent africain : les fermetures d’ambassades et consulats se succèdent, les programmes d’aide et les centres culturels sont en déclin. L’Afrique n’est plus une priorité pour Moscou.
Il faudra près de 20 ans au Kremlin pour revenir progressivement sur le continent. Cette fois, non pas avec une idéologie, mais avec des contrats. Trois ans après un voyage de Vladimir Poutine au Maroc, le président Dimitri Medvedev se rend en Angola, en Namibie et au Nigeria, accompagné de 400 hommes d’affaires. Un poste de conseiller pour l’Afrique est même créé au sein du Ministère des Affaires Étrangères russe.
Près de dix ans après la reprise de liens économiques avec le continent africain, le Kremlin semble vouloir sortir de ses zones d’influence traditionnelles sur le plan militaire. Cette fois, c’est avec armes et bagages que des instructeurs militaires russes viennent de s’installer en Centrafrique début 2018.
Coopération militaire, investissements économiques, soutien à la lutte contre le terrorisme : après des années d’absence entre la chute de l’Union soviétique et la fin des années 2000, la Russie fait son grand retour sur le continent africain.
Un passage obligé, pour étendre sa sphère d’influence?
Du Congo à l’Egypte, du Nord au Sud, le retour de la Russie en Afrique
L’Assemblée nationale de RDC vient de revalider un vieil accord de coopération militaire et technique avec Moscou, prévoyant entre autres la livraison d’armements, des missions de conseils et des formations de spécialistes en Russie. Gestes diplomatiques de haut niveau, multiplication d’accords : le regain d’attentions de la Russie pour le continent africain est manifeste. Au delà de l’intérêt pour ses ressources et son marché, il représente pour Moscou – enhardi par ses succès au Proche-Orient et l’impuissance occidentale -une nouvelle projection stratégique.
Nulle invasion spectaculaire ni bombardements de dollars ou de roubles mais de multiples actes de présence et d’avancements qui, si l’on prend la peine de regarder le puzzle dans son ensemble, expriment une évidente cohérence. La seule liste de ses pièces est éloquente.
RDC
La dernière n’est pas la moindre : la République démocratique du Congo, quatrième pays du continent, 80 millions d’habitants, épuisée par des décennies de guerres et de crises politiques chroniques. Moscou et Kinshasa ont exhumé ces derniers jours une convention bilatérale, signée en 1999 mais jamais appliquée. Elle prévoit la livraison par la Russie d’armements, de matériels de guerre mais aussi des missions de conseils et la formation de spécialistes.
Centrafrique
Pas très loin de là, dans une République centrafricaine non moins déchirée et au sous-sol non moins attrayant, une quarantaine de soldats des forces spéciales russes viennent de se voir affectés à la garde rapprochée du président Faustin-Archange Touadéra, jusqu’alors assurée par des casques bleus rwandais de la Minusca (mission des Nations-Unies en Centrafrique). Ils font partie d’un contingent russe déployé dans le cadre d’une livraison d’armes en janvier dernier pour une « mission de formation et de sécurisation ». Détail savoureux : ils occupent, loin des yeux indiscrets, l’ancien palais impérial de Jean-Bedel Bokassa.
Afrique de l’Ouest
L’intérêt mutuel russo-africain se manifeste aussi à l’Ouest du continent. Président de la Guinée-Conakry et fidèle allié de la France, Alpha Condé a fait en septembre dernier le voyage de Moscou où il a été chaleureusement reçu par Vladimir Poutine.
Huit accords de coopération ont été signés à cette occasion, prévoyant la construction de « quatre C.H.U. » (centre hospitaliers universitaires) et de « plusieurs garnisons militaires ».
Le Burkina Faso a également annoncé à l’automne dernier un renforcement de sa coopération avec la Russie. Rien de grandiose mais le petit pays en proie aux menaces d’Aqmi lui a récemment passé commande de deux hélicoptères de transport et d’attaque Mi-171Sh.
Toujours à l’ouest, la coopération russo-sénégalaise donne également quelques signes de relance, en particulier dans le domaine énergétique après la découverte de gisements prometteurs de gaz.
Afrique du Nord

Au nord-est du continent, L’Égypte est demeurée une partenaire privilégiée de la Russie en dépit de ses bouleversements internes. Vladimir Poutine, qui ne ménage pas son soutien au maréchal Abdel Fattah al-Sissi est venu le visiter deux fois au cours des trois dernières années.
Un instant mises à mal par le crash de l’Airbus d’Égypt-Air après son décollage du Caire en octobre 2015, qui a stoppé le flux touristique russe, les relations entre les deux pays ont vite été relancées.
Elles portent d’abord sur le nucléaire civil : la fourniture par Moscou de quatre réacteurs dans les années à venir. Coût : 25 milliards d’euros financé par prêt russe. Investissement de haute portée qui n’est pas sans rappeler la construction du barrage d’Assouan dans les années 60.
Elles portent aussi sur la création en Égypte d’une vaste « zone industrielle russe » : « Cela sera le plus grand centre de production et d’exportation de biens russes sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique. Nous prévoyons un volume total d’investissement de sept milliards de dollars environ (six milliards d’euros) », en a dit Vladimir Poutine.
Le Soudan voisin n’est pas oublié. En délicatesse avec la « communauté internationale » – il est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la C.P.I. pour crimes contre l’humanité au Darfour
Ultime signe, s’il en manque, de retour de la Russie sur le continent : la tournée très significative de Setgueï Lavrov en Afrique australe en mars dernier. Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibie, Éthiopie. Cinq pays (ou lieux, car certains États n’étaient pas nés ou portaient un autre nom) où l’Union soviétique a joué un rôle important – guerre indirecte comprise – avant son effondrement.
De nombreuses entreprises russes y opèrent toujours, notamment dans le secteur minier. L’Angola reste liée à Moscou par des accords de défense. « L’un des grands atouts dont dispose indéniablement la Russie pour la suite de cette collaboration est qu’une large partie des élites politico-économiques de ces pays sont [restées] prorusses ».
Moscou ne dispose sur le continent ni des moyens humains et matériels de la Chine – prête à y déverser des milliers de milliards de dollars pour s’y assurer des ressources naturelles et alimentaires
Macron en Afrique : le passé colonial de la France, «une faute morale»

En visite officielle en Côte d’Ivoire, le chef de l’Etat avait appelé le samedi le 21 décembre 2019 à écrire une « nouvelle histoire commune » avec l’Afrique.
Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara, ont eu à cœur de tourner la page d’un « vestige douloureux de la Françafrique », le franc CFA. D’accord, le président Français n’a cessé d’appeler de ses vœux une « relation passionnée », « nouvelle et décomplexée » avec la Côte d’Ivoire, manière de se départir d’un passé colonial douloureux. Il est pourtant des usages qui ne sont pas près de changer.
Ces gigantesques pancartes « Akwaba » (bienvenue, en langue Akan) à l’effigie du chef de l’Etat et de son homologue, positionnées sur le trajet du cortège présidentiel français. Ces bâtiments repeints pour l’occasion, parfois encore collants. Ces mots doux de la presse officielle pour raconter par le menu la « visite historique » du Français dans le pays. « A cinq jours de la naissance de l’Emmanuel de la Bible, le président français porte bien son nom, Emmanuel Macron a apporté la douceur de la gaieté à ses troupes, loin des théâtres âpres de guerre », décrivait ainsi le quotidien « Fraternité matin ».
Pas un mot sur les grèves françaises( Gillets Jaunes) ou la réforme des retraites sur lesquelles le président a gardé silence pendant de sa visite à Abidjan.
Des cadeaux pour son anniversaire

A 5 000 km de la France, c’est peu dire que le chef de l’Etat avait été reçu avec égards. Ce n’etait pas parce qu’il fêtait son 42e anniversaire qu’Emmanuel Macron avait été fait chef traditionnel ivoirien à Abidjan. Lors d’une cérémonie, il s’était vu gratifié du nom « N’Djékouale », c’est-à-dire « la paix, la sérénité, le chercheur de paix, le faiseur de paix, l’ouvrier de la paix », rien de moins. En guise de cadeau, le président a reçu les attributs des chefs traditionnels, pagne, couvre-chef, chasse-mouches et sandales, qu’il a pris soin… de ne pas porter.
Tout au long de la journée, les Ivoiriens n’ont cessé de célébrer son anniversaire. Par le biais d’une fanfare, de chants, et même d’une phrase attentionnée de son homologue. Un proche esquisse un sourire crispé : « Il n’aime pas trop ça… »
« Une nouvelle histoire »
Est-ce par pudeur ou parce que ces marques de considération peuvent souligner une histoire qu’il semble déterminé à dépasser ? « Je n’appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme, insiste-t-il. Rompons les amarres, ayons le courage d’avancer. La France n’a aucun privilège, elle n’a qu’à aider. » Ce passé ? « Une faute morale », lâche celui qui plaide pour une « nouvelle histoire commune ».
Un tableau dans lequel les relations économiques entre les deux pays restent vivaces : « Je souhaite que les entreprises françaises restent des acteurs majeurs de cette croissance. Des acteurs heureux et harmonieux. » Certains usages ne sont pas près de changer.
Emmanuel Macron, du discours à la méthode ?
Coopération économique accrue, dialogue politique renforcé, gestes symboliques forts… Emmanuel Macron a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre Paris et le continent.
C’était il y a deux ans, à l’université de Ouagadougou. Face à un amphithéâtre bondé d’étudiants burkinabè, Emmanuel Macron, arrivé six mois plus tôt à l’Élysée, y délivrait sa vision de la « nouvelle » relation qu’il entendait tisser avec l’Afrique. En formulant une promesse martelée par ses prédécesseurs depuis le général de Gaulle : celle d’en finir avec la Françafrique, ses liens malsains et ses réseaux obscurs.
Rien de très neuf, donc, si ce n’est un changement en termes d’image et de méthode. Un président français pas encore quarantenaire qui se plie à une séance de questions-réponses musclée avec son jeune auditoire, en direct et sans filet de rattrapage.
Emmanuel Macron a eu beau assurer qu’il n’y avait « plus de politique africaine de la France », son désormais célèbre discours de Ouagadougou décline une à une les grandes mesures qu’il entend prendre sous son quinquennat. « C’est une feuille de route, confirme-t-on à l’Élysée. À part sur l’Europe, il n’y a aucun autre domaine où le président a clairement affiché ses intentions de la sorte. »
« Marqueurs symboliques »
Conçu avec les membres de son Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA), composé d’une douzaine de personnalités françaises et africaines issues de la société civile, ce discours-programme entend marquer une rupture et le début d’une nouvelle ère.
Objectif affiché : bâtir une relation normalisée passant uniquement par les canaux officiels.
Parmi la batterie de mesures annoncées à Ouagadougou, certaines, considérées par son entourage comme des « marqueurs symboliques », ont été rapidement prises. Les archives françaises sur l’assassinat de Thomas Sankara ont ainsi été transmises à la justice burkinabè, et le processus de restitution du patrimoine culturel africain a été enclenché, en particulier avec le Bénin.
Autre symbole fort : le rapprochement avec le Rwanda de Paul Kagame, notamment à travers le soutien à Louise Mushikiwabo pour son accession à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), à la fin de 2018.
Pour le reste, une des grandes idées directrices de la gouvernance macronienne en Afrique est de sortir du « logiciel de crise » pour mettre l’accent sur une coopération accrue dans des secteurs plus classiques, comme l’éducation, l’entrepreneuriat, le développement durable ou encore la culture et le sport. Mais c’est surtout en termes économiques qu’Emmanuel Macron et ses conseillers envisagent leurs relations avec leurs partenaires africains.
D’où l’intérêt accordé aux poids lourds non francophones du continent, comme le Nigeria, le Ghana ou encore l’Éthiopie, trois pays où le président s’est rendu tour à tour depuis son arrivée au pouvoir. Toujours dans la même logique, il se rendra en Afrique du Sud et en Angola au mois de mai 2020. À chaque fois, des entrepreneurs et des investisseurs français l’accompagnent pour tenter de saisir les opportunités dans les pays concernés. Avec plus ou moins de succès.
« Il y a des blocages persistants, estime une source au Palais. La conversion du regard de nos opérateurs économiques sur l’Afrique ne change pas assez vite. Nous avons encore du mal à les convaincre de venir y développer des nouveaux projets. » Aussi ambitieux et bien marketé soit-il, le discours présidentiel sur le changement des relations franco-africaines se heurte à certaines réalités moins séduisantes.
À commencer par la coûteuse opération Barkhane au Sahel, où plus de 4 000 militaires français ont été déployés depuis 2014. Difficile, en effet, d’évoquer la fin de la Françafrique alors que Paris mène sa plus importante opération extérieure sur le continent depuis les indépendances. Le président français, dont les propos sur le taux de natalité dans certains pays africains avaient déjà créé la polémique en 2017, est aussi régulièrement fustigé pour sa politique migratoire à l’égard du continent.
Après le discours de Ouaga, le CPA sera une nouvelle fois appelé à jouer un rôle dans la préparation de ces deux temps forts. En s’appuyant notamment sur les diasporas, dont le chef de l’État souhaite qu’elles constituent un vecteur privilégié d’échanges avec l’Afrique.
Pression sur le Cameroun…?
« J’avais dit au Président Biya: “Je ne veux pas qu’on se voit à Lyon tant que Maurice KAMTO n’est pas libéré“
La libération de Maurice Kamto, c’est le résultat de pressions de la France, notamment de son président de la République. C’est le chef d’État français Emmanuel Macron qui le révèle lui-même.
Le président français Emmanuel Macron dénonçait, le samedi 22 février, des violations des droits de l’homme « intolérables » au Cameroun, après la mort de plusieurs personnes au cours d’une opération militaire. Le chef de l’État français s’exprimait alors en marge du Salon de l’agriculture, à Paris, après avoir été interpellé par un visiteur, sur cette question.
« J’avais dit au Président Biya: “Je ne veux pas qu’on se voit à Lyon tant que Maurice KAMTO n’est pas libéré“. Et il a été libéré parce qu’on a mis la pression », avait révélé Emmanuel Macron.
C’était suite à une interpellation d’un activiste camerounais de la BAS que le président français avait fait cette révélation.
La scène se déroulait dans les allées bondées du Salon de l’agriculture de Paris. Un activiste camerounais interpellait le président Macron qu’il apercevait au loin. Le président français, dans un premier temps, faisait semblant de ne pas l’entendre. L’activiste avit alors insisté à attirer l’attention d’Emmanuel Macron qui engageait cette discussion.
« Vous savez mon engagement sur ce sujet. J’ai mis la pression sur Paul Biya pour que, d’abord, il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J’avais dit : je ne veux pas que l’on se voie à Lyon, tant que Maurice Kamto n’est pas libéré. Il a été libéré parce qu’on a mis la pression », rappelle le chef de l’État français.
Concernant la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Emmanuel Macron avait indiqué qu’il allait mettre la pression nécessaire sur le Président Biya pour faire cesser les violations notées dans les régions anglophones.
Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun. Je fais le maximum », avait ajouté le président Emmanuel Macron.
Par Tinno BANG MBANG
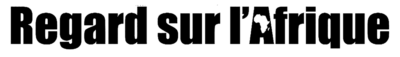














































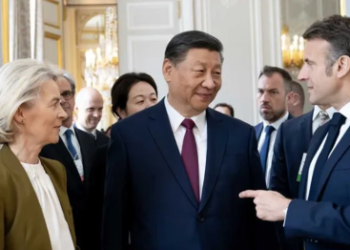







Discussion à propos du post