Les pays développés devraient se soucier particulièrement de l’Afrique. Certains pays en voie développement représentent aujourd’hui environ 30 % des échanges internationaux. Les politiques de développement n’ont donc plus aujourd’hui pour unique objet la lutte contre la pauvreté et le respect des objectifs du Millénaire pour le développement de l’Afrique. Elles ont également une influence profonde et systémique sur la santé économique du monde entier.
Le financement du commerce est plus que jamais vital
Comme le suggèrent les dernières Perspectives économiques en Afrique, les pays où les liquidités abondent, notamment la Chine, pourraient, avec les organismes multilatéraux régionaux comme la Banque africaine de développement, mettre en place les financements nécessaires.
Une bonne gouvernance est primordiale
L’accroissement des échanges et de l’aide aura peu d’effets en l’absence de mesures sur d’autres fronts, comme la gouvernance politique. Des problèmes particulièrement graves demeurent, comme la catastrophe humanitaire dans la région du Darfour au Soudan, l’effondrement économique au Zimbabwe et les troubles politiques en Guinée, en Côte d’ivoire, en Somalie, au Burkina Faso, au Mali, en Libye, en Centrafrique et au Cameroun.
La corruption fait également des ravages dans certains États. Préserver la stabilité politique et sociale s’avérera délicat, surtout si les cours des produits de base s’envolent à nouveau dans les mois à venir.
On relève cependant des signes encourageants. Le renforcement de la conscience politique des populations a responsabilisé certains gouvernements. Désormais, ceux-ci organisent des élections régulières et procèdent à des réformes structurelles de l’administration publique, instaurant une meilleure gouvernance et plus de transparence. En outre, certains pays ont connu des améliorations en termes de gestion macroéconomique et de cadre réglementaire. La coopération régionale en matière de gouvernance, dans le cadre de l’Union africaine et du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, est également encourageante. Cependant, si les conflits violents ont diminué, l’instabilité sociale s’est globalement aggravée en Afrique entre 2007 et 2008, et de nombreux gouvernements ont réagi en prenant des mesures radicales. L’évolution de la situation face aux difficultés économiques est source d’inquiétude.
Des défis majeurs restent aussi à relever dans des domaines comme le développement et l’entretien des infrastructures, les télécommunications et l’investissement. La technologie offre un élément de solution. En effet, les applications novatrices des technologies de l’information et des communications (TIC) permettent de faciliter l’essor des marchés.
Grâce à ces innovations, les entreprises peuvent, pour la première fois, fournir des services modernes aux habitants du continent. Dans l’agriculture, les TIC ont rapproché les exploitants et les acheteurs au sein de marchés en ligne plus transparents. L’intégration régionale devrait se renforcer d’avantage grâce à la construction de nouvelles liaisons terrestres à haut débit.
Les pays africains importateurs de pétrole et d’autres produits de base sont eux aussi confrontés à des difficultés. Dans de nombreux pays du continent, les plus démunis souffrent, surtout en ville, du prix toujours élevé des denrées alimentaires importées. Parallèlement, l’inflation progresse, la hausse des cours alimentaires internationaux enregistrée ces dernières années étant largement répercutée sur les consommateurs avant l’arrivée de la pandemie du Covid-19 n’a pas changé.
Première pandémie planétaire depuis un siècle, la propagation du Covid-19 révèle les limites des sociétés et des économies à travers le monde. Pour les érudits en économie, cette crise sanitaire provoquera la récession la plus brutale et la plus sévère de mémoire d’homme. Le dernier né des coronavirus a déjà fait des centaines de milliers de morts depuis son apparition en Chine en décembre dernier. Il a contraint de nombreux gouvernements à confiner leurs populations à un niveau impensable jusqu’à récemment. L’économie mondiale a été littéralement mise à l’arrêt.
L’Afrique subsaharienne n’est pas en reste.
L’impact économique du Covid-19 en Afrique sub-saharienne est double. Au niveau interne, les mesures de confinement ralentiront l’activité économique. Au niveau externe, les pays souffriront de l’effondrement des cours des matières premières, de l’incertitude autour de l’aide publique au développement et des transferts de fonds de la diaspora en raison de la récession annoncée dans les pays développés. Les États dépendants du tourisme mondial connaîtront une baisse drastique de la production de services et des recettes publiques. Sur le plan financier, l’incertitude sur les marchés aura pour impact de rendre davantage difficile l’accès aux capitaux mondiaux.
La pandémie de Covid-19 est une occasion historique pour réinventer le développement de l’Afrique
Face à la crise du Covid-19, la plupart des pays envisagent de repenser leur modèle économique. Certains pays développés entendent relocaliser tout ou partie de leur tissu productif stratégique afin de réduire leur dépendance envers la Chine, l’union européenne et les États-Unis.
Pour briser son accoutumance aux crises de toute nature, l’Afrique subsaharienne se doit elle aussi de rompre avec son modèle économique actuel. Sans être exhaustifs, les points ci-dessous doivent être au cœur de ce changement de paradigme :
- Bâtir de vrais États régaliens. Les États doivent assurer la fourniture des infrastructures de base (eau, santé, éducation) et des infrastructures structurantes (transport, énergie) partout sur leur territoire et garantir la sécurité des populations. Une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et une gestion efficace des ressources publiques doivent être au cœur de cette construction. C’est la condition nécessaire à la fois pour le développement du secteur privé et l’émergence de citoyens responsables et conciliants vis-à-vis de la fiscalité.
- Former un capital humain adapté. L’offre du système éducatif doit être cohérente avec les avantages comparatifs révélés et latents ainsi qu’avec les défis de la mondialisation. Les défis de productivité dans l’agriculture et l’agro-industrie, l’auto-entrepreneuriat et les sciences doivent être au cœur des offres de formation pour bâtir un modèle de développement autour d’une classe moyenne forte et économiquement résiliente. Par ailleurs, il urge d’investir massivement dans les infrastructures de santé pour sortir de la fragilité structurelle des systèmes de santé et garantir un capital humain de qualité.
- Construire des modèles de développement endogènes. Bien qu’il existe autant de modèles de développement que de pays, il s’agit d’assurer l’adéquation des plans de développement avec les dotations naturelles, l’histoire et la culture des États africains. L’Afrique doit renouer avec la planification de ses grands défis de transformation structurelle tout en évitant les travers de la gouvernance du passé.
- Formaliser l’informel. La construction de vrais États régaliens ainsi qu’un capital humain adapté y contribue beaucoup. Mais au-delà, il est impératif de veiller à la suppression de toutes les procédures administratives contraignantes et inutiles, à la transparence et à la force des règles et au renforcement de l’inclusivité financière, notamment pour les femmes.
- Industrialiser l’Afrique. Il urge de rompre le cercle vicieux de la dépendance débridée aux matières premières brutes. Les économies doivent donc s’industrialiser pour créer de la richesse en capitalisant sur leurs ressources naturelles et leur capital humain. Les stratégies industrielles doivent aussi s’appuyer sur des partenariats stratégiques et le développement des secteurs à fort contenu technologique. Une gestion rigoureuse et transparente de la dette et des ressources liées à l’exportation des matières premières est indispensable dans la phase de transition.
- Accélérer la transition numérique. Le saut numérique a l’avantage du gain d’efficacité. La création de compte mobile money, une spécificité de l’Afrique subsaharienne, a permis de desserrer drastiquement certaines contraintes de financement au niveau microéconomique. Les États doivent continuer d’investir massivement dans la digitalisation de leurs économies, à tous les niveaux, pour vaincre bien d’autres fléaux dont la mal-gouvernance. Le numérique est un allié clé pour une formalisation de l’économie souterraine et une plus grande mobilisation des ressources internes.
Par Tinno BANG MBANG
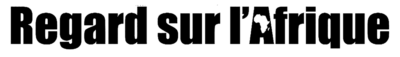



















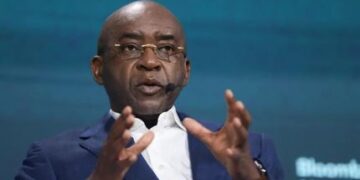































Discussion à propos du post